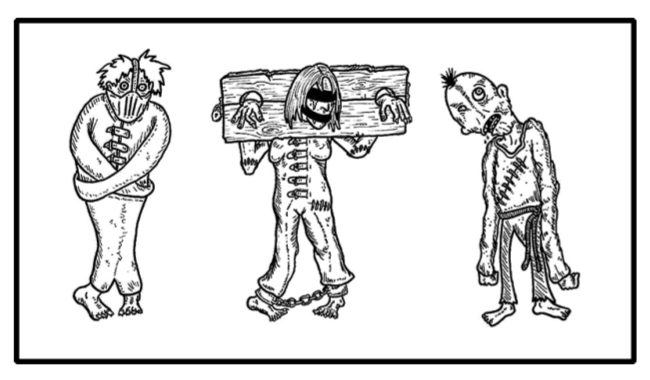Témoignage d’un ancien détenu de l’HP : “l’hôpital a voulu me figer dans la maladie”
Le Poing, n°28 – Souffrant de troubles bipolaires, j’ai été détenu à Lyon, entre 2009 et 2013, dans l’hôpital psychiatrique public « Le Vinatier », quatre fois deux mois, et à la Villa des roses, une clinique privée, environ quatre mois. Militant anticapitaliste, professeur de philosophie et théoricien révolutionnaire, je propose ici un témoignage certes partial, mais qui se voudra le plus descriptif possible : en ce qui concerne ce genre de lieux d’enfermement, la simple description suffit à les dénoncer radicalement, sans qu’il faille nécessairement faire preuve de radicalité critique outrancière.
L’hôpital psychiatrique, ou la clinique privée, est un lieu dans lequel on se rend très souvent par obligation. Personnellement, j’ai été trois fois enfermé par HDT, c’est-à-dire « à la demande d’un tiers » (personnes de la famille, ami·e·s, etc.). Une fois, d’office (HO), c’est-à-dire que c’est le préfet de police qui a estimé que j’étais une menace pour l’ordre public. Je m’étais pourtant contenté de pousser une porte avec un extincteur, de façon humoristique, dans l’aéroport de Lyon, ce qui n’est pas bien méchant. Mais lorsqu’on ajoute à cela des troubles d’ordre cognitifs, une psychose répressive s’empare très vite des pouvoirs publics, encadrants ou « soignants ». L’enfermement est peut-être une solution reposante pour les ami·e·s et l’entourage mais pour soi-même, elle est un sentiment d’exclusion et de marginalisation, qui rendra encore plus difficile la « réinsertion » dans « l’ordre social », qui est la condition assez désolante de toute « amicalité » et de tout « lien familial » contemporain.
Le Vinatier : un hôpital héritier des pratiques morbides de Vichy
Les patients, ultra-sensibles, ressentent les « ondes » négatives de l’hôpital. Il se trouve que dans les années 1940, aux Vinatiers, on faisait des expériences mystérieuses sur les personnes dites handicapées (handicapées par une société morbide et malade, devrait-on dire ici). Le ou la patient·e ressent ce passif qui l’étouffe, et dont les structures fondamentales n’ont pas été vraiment modifiées. D’ailleurs, les locaux des Vinatiers sont à peu près les mêmes que ceux des années 1940 pendant la collaboration(1)…
Le médecin traite le personnel infirmier avec condescendance, alors que ce sont ces personnes pragmatiques qui font concrètement le travail de soin, et se salissent les mains en distribuant aux patients ce qui est trop souvent du poison (« médicaments » : anxiolytiques, neuroleptiques, antipsychotiques, antidépresseurs, etc.) Les infirmières et infirmiers font ce qu’ils et elles peuvent, mais sont débordé·e·s, et souvent méprisé·e·s, non seulement par les supérieurs hiérarchiques, mais aussi par les « malades » (souvent à juste titre, hélas, étant données les conditions objectives, que les « soignants » ne choisissent pas).
Les médecins gèrent des « patients » mais ne soignent pas
 Le ou la « médecin » quant à lui, nous voit une fois par semaine, et décide de notre sort sur la base d’un vague coup d’œil. Il connaît mal son dossier (ainsi, il confond tout en ce qui concerne mon histoire familiale), et il est incapable de faire une minute de psychothérapie ou de psychanalyse. Il fait que je me sens nul, jugé, minable, bientôt sous curatelle (sa préconisation), ou pourquoi pas dans un « appartement thérapeutique » (avec d’autres dépressifs, victimes ou victimisé·e·s : rien de mieux pour rester soi-même dépressif que de rester avec d’autres frères et sœurs de souffrance qui se sentent également exclu·e·s).
Le ou la « médecin » quant à lui, nous voit une fois par semaine, et décide de notre sort sur la base d’un vague coup d’œil. Il connaît mal son dossier (ainsi, il confond tout en ce qui concerne mon histoire familiale), et il est incapable de faire une minute de psychothérapie ou de psychanalyse. Il fait que je me sens nul, jugé, minable, bientôt sous curatelle (sa préconisation), ou pourquoi pas dans un « appartement thérapeutique » (avec d’autres dépressifs, victimes ou victimisé·e·s : rien de mieux pour rester soi-même dépressif que de rester avec d’autres frères et sœurs de souffrance qui se sentent également exclu·e·s).
L’un d’entre eux, le docteur B., m’a dit « d’arrêter la philosophie », alors que j’avais déjà un master 1 (mention bien) dans la discipline. Il m’a figé dans la maladie sans me connaître, sans prendre le temps de connaître mes désirs et mon histoire, sans me parler de mes traumatismes passés, dépassables quand on les formule. Si ma mère, qui me prenait en charge, l’avait écouté, je moisirais à l’heure actuelle dans un appartement thérapeutique, sous curatelle. Il se trouve qu’elle ne l’a pas écouté, et que j’ai été reçu 15e au concours de philo (1er à l’écrit), et que je publierai dans la foulée plusieurs essais théoriques(2), ce qui m’a redonné un peu le goût de vivre.
Autrement dit, ces « soignants », avec leur autorité irresponsable, sont capables de détruire des vies en une seule phrase, sans s’en soucier, puisqu’ils n’ont affaire qu’à des chiffres. Mais ces « médecins » sont aussi des « individus pressés ». Ils ont des comptes à rendre, administrativement et quantitativement parlant, à une autre hiérarchie, et sont à leur tour « victimes » de cette situation : on les « force » à devenir de tels bourreaux insensibles, et rien ne dit que ce « on » soit vraiment « humain » (Marx parle de « sujet-automate » lorsqu’il évoque la norme productive : elle est d’abord un critère abstrait, qui n’a pas de visage et pas de spécificité qualitative « humaine »). Ainsi, de même que le « médecin » impose à « ses » infirmiers et infirmières de distribuer « son » poison (ou celui des dealers pharmaceutiques dont il est le revendeur), il est lui-même soumis à l’administration publique qui le rémunère et exige qu’il développe une sociabilité empoisonnante avec « ses » patient·e·s pour que ces dernier·e·s soient démoralisé·e·s et se résignent à leur sort, condition nécessaire pour que l’ordre établi perdure.
Les « soins » qui consolident d’autres pathologies
Les médicaments marchent une fois sur deux (ou sur trois, ça dépend). Si le patient a la malchance d’avoir une maladie rare (et donc non subventionnée), alors il ne sortira que difficilement des mailles du filet. Si son « capital génétique » est peu courant, certains médicaments standards ne fonctionneront pas, et il devra subir, comme un cobaye, peut-être une dizaine de traitements, avant de trouver « le bon ». S’il n’est toujours pas « bien diagnostiqué », il subit des traitements inappropriés, qui peuvent accroître son mal, ou en produire des nouveaux. Ainsi, je connais une jeune femme qui souffrait d’une dysmorphie bénigne(3), mais dont le diagnostic n’était pas « clair », et qui a essayé « tout un tas de traitements » inadaptés, jusqu’à développer une schizophrénie grave, et loin d’être bénigne.
De même, une patiente qui est devenue une de mes amies, a développé des crises d’angoisse aiguës dans le même temps où elle aurait été « traitée » pour des accès de panique. Pour guérir de ces crises, elle a été contrainte de recourir à d’autres traitements, produisant d’autres effets secondaires, appelant de nouvelles « cures », etc., indéfiniment. Dans un tel contexte, il paraît « logique » que les patients restent souvent très longtemps dans les hôpitaux, même si c’est pour soigner des troubles d’abord bénins.
Un autre ami, régulièrement pris d’accès de fureurs incontrôlables, mais surtout dus à un passif familial très lourd, n’a pas eu la chance de bénéficier de psychothérapies adaptées, et a été traité chimiquement pour une souffrance qui était d’abord psychologique, et dérivait essentiellement de son histoire personnelle, et non pas de dysfonctionnements cognitifs au sens strict. Il a ainsi développé tous les troubles « collatéraux » qu’impliquent de tels traitements, mais sans avoir pu abolir sa souffrance intime, qui supposait une cure par la parole très spécifique, cure qui ne sera jamais sérieusement dispensée dans les hôpitaux psychiatriques.
L’État-marchand a besoin de personnes à maintenir sous tutelle
 Abjectement, ces essais faits sur de tels cobayes répondent à une logique économique aveugle et automatisée. Ceux qui produisent et vendent les médicaments ont tout intérêt à faire en sorte que les traitements soient inadaptés, car ils rendent alors nécessaire la prise d’autres médicaments pour « gérer » les effets secondaires des premiers médicaments (les deuxièmes médicaments censés gérer les effets secondaires des premiers médicaments peuvent au contraire entrainer d’autres effets secondaire rendant nécessaires la prise d’un troisième médicament, etc.)
Abjectement, ces essais faits sur de tels cobayes répondent à une logique économique aveugle et automatisée. Ceux qui produisent et vendent les médicaments ont tout intérêt à faire en sorte que les traitements soient inadaptés, car ils rendent alors nécessaire la prise d’autres médicaments pour « gérer » les effets secondaires des premiers médicaments (les deuxièmes médicaments censés gérer les effets secondaires des premiers médicaments peuvent au contraire entrainer d’autres effets secondaire rendant nécessaires la prise d’un troisième médicament, etc.)
Cette forme étatique du « soin » a besoin de personnes à maintenir sous tutelle, à enfermer, et s’accommode très bien de cette logique « d’effets secondaires » propre à la pharmaceutique privée. Cette logique du pompier pyromane se retrouve très bien au sein des ordres « humanitaires » (la Croix Rouge est financée en partie par l’entreprise pharmaceutique Johnson and Johnson’s(4)) ; et au sein des ordres de la répression de l’éducation (je fais ici mon autocritique : on m’impose, comme prof, dans les conseils de classe, de reproduire ce que j’ai subi, et de devenir un bourreau à mon tour, puisqu’on m’a dit que « l’intégration sociale » avait cette violence, faite à l’autre et à soi, pour condition).
Indépendamment de ces considérations pharmacologiques, ce qui paraît aussi très choquant dans les hôpitaux psychiatriques, c’est la manière dont on « gère » les patients comme des meubles un peu encombrants que l’on « pose » ici ou là, en les laissant ruminer leurs souffrances en silence. Pendant ce temps, la plupart d’entre eux fument plusieurs paquets de cigarettes par jour, sans que cela semble constituer un vrai problème pour les « soignants ». Au contraire, le temps que le patient passe à une telle occupation, en se détruisant les poumons et le reste, est un temps où les « soignants » ne sont pas mobilisés, et où on les laisse « respirer » un peu. Le patient peut défouler compulsivement sa pulsion suicidaire lente et douloureuse à travers une telle pratique, pul sion déjà bien développée par le contexte hospitalier. Les programmes pour arrêter le tabac, à l’usage des patients, se font ici assez discrets. On voudrait ne soigner que le cerveau, et l’on oublie le reste du corps, qui participe pourtant de l’équilibre psychophysique d’ensemble. La biomédecine instrumentale isole très souvent une partie du corps, à l’image de sa division indéfinie en spécialités et sous-spécialités médicales multiples, et elle ne saisit plus la globalité du corps des soigné·e·s.
L’enfermement est toujours une souffrance
De façon générale, le fait que des délirants soient tous enfermés dans le même lieu ne favorise pas la guérison des délires : un délire en entraîne un autre, les délires se consolident et se contaminent mutuellement. Idem pour les dépressions. La pauvreté de cette sociabilité fait que les patients resteront très souvent entre eux, même après être sortis de l’hôpital. Leur marginalité est affermie par le fait qu’on les a tous « mis dans le même panier », pour les enfermer dans un même lieu, où ils se reconnaîtront entre eux selon des critères mutilants et unidimensionnels. Dans la sphère du salariat « valide », ou dans leur famille « valide », ils ne se sentiront jamais vraiment à leur place, et auront l’impression que seuls leurs frères et sœurs de souffrance les comprennent.
Des lieux de soin où les personnes souffrantes ne seraient pas enfermées, développeraient leurs talents propres, et côtoieraient des personnes plus épanouies, non souffrantes, pour entreprendre des projets émancipateurs, restent à inventer réellement. L’anti-psychiatrie a pu aller dans ce sens, à un certain moment, mais les puissances conservatrices étouffent trop souvent ce genre d’élans. Quoi qu’il en soit, il est insensé, voire sadique, de mettre ensemble pendant plusieurs mois des individus qui sont tous désespéré·e·s, délirant·e·s, ou hanté·e·s, sans autre compagnie que des « soignants » qui les négligent ou les infantilisent : ils ne font que développer davantage leurs souffrances ou sentiments de marginalité dans un tel contexte, et finissent d’ailleurs par se détester entre eux, trop souvent (surtout si l’un d’entre eux guérit finalement, et devient à nouveau un « valide », c’est-à-dire une sorte de traître, qu’on jalouse ou méprise).
Il y aura certes parfois, au « programme de la journée », des activités manuelles, ou des ateliers d’écriture, qui pourront être prévus. Quoique cela reste très rare, et très ponctuel. Mais ces activités sont aussi des humiliations subtiles : la personne « handicapée » ici est niée comme artiste, ou comme personne créative, et elle fait l’atelier simplement pour « se soigner », « se réadapter », c’est-à-dire en tant qu’elle est cataloguée comme malade. De nombreux patients développent un certain génie créatif lors de ces séances : mais on leur tapera gentiment dans le dos, en leur disant que ce qu’ils font « est bien pour eux », et en sous-entendant qu’ils pourront bientôt « se réinsérer » dans le « monde normal » qui les a pourtant aussi sauvagement assignés et rendus malades.
Nous sommes tous des bourreaux, nous sommes tous des survivants
Clément Homs, dans Sortir de l’économie développe la notion « d’Eichmann-que-nous-sommes-tous »(5). Nous sommes tous « obligés », infirmières, soignants, médecins, professeurs, industriels, prolétaires, de détruire autrui pour exister « socialement ». En effet, nous collaborons tous, ne serait-ce que pour survivre, à un encadrement, un « soin », une alimentation, une médication, une administration, une répression, une discipline, qui sont fondamentalement destructeurs, au sein de notre modernité désertique et désastreuse, capitaliste et étatique. Le « fou », toutefois, devenu conscient de cette situation, une fois « guéri » (et ce grâce aux soins fort imparfaits, mais parfois efficients, desdits « soignants », qui sabotent alors malgré eux leur système morbide) peut témoigner des violences sociales qu’il a subies, et devenir un sujet révolutionnaire intéressant.
Le ou la schizophrène en rémission dévoile la mise en camp de tout un chacun et de chacune, au sein de la modernité suicidaire. Le ou la dépressive, en rémission, dévoile le caractère affreusement triste et désolant de cette modernité. Le ou la bipolaire évoque les sursauts maniaco-dépressifs, indéfinis et épuisants de ladite économie. L’autiste Asperger, incapable de reconnaître les émotions sur les visages, dévoile le cynisme psychopathique et l’hypocrisie constante de nos contemporains, qui sourient souvent pour nous affamer, nous mépriser, nous enfermer, nous congédier, ou nous licencier.
Ces sujets révolutionnaires, hélas, ne sont pas assez pris au sérieux dans les luttes politiques et sociales qui sont trop « rationnelles », « professionnelles » et « logistiques ». Le militant méprise trop souvent le « fou » au sein de sa lutte pseudo-révolutionnaire. Une expression éloquente se développe dans nos milieux : le « schlag ». Cette personne, vivant dans la rue, souffre pourtant souvent d’une psychose dure, et j’aurais pu en devenir un. Ce racisme social doit cesser si nous désirons fédérer tous les individus, quels qu’ils soient, au sein d’une lutte qui ne concerne pas seulement les petits-bourgeois qui ont lu Marx.
Textes de Benoit, dessins de Titi
(1) « Les handicapés victimes de Vichy sortent de l’oubli », La Croix, 16 février 2015.
(2) Pour lire quelques-uns des textes théoriques de l’auteur de cet article, rendez-vous sur benoitbohybunel.over-blog.com.
(3) En psychologie, le dysmorphisme désigne le décalage pathologique entre la réalité et la manière dont le sujet perçoit son corps. Ainsi, une perdsonne souffrant de dysmorphie musculaire se trouvera constamment chétive, même si elle est en fait une personne culturiste ou athlétique. En médecine, le mot dysmorphisme est employé comme synonyme de dysmorphie : forme anormale.
(4) redcross.ch, « Aide aux proches de personnes atteintes de démence : Johnson & Johnson soutient le travail de la CRS », Croix-Rouge suisse, 21 septembre 2015.
(5) Adolf Eichmann est un criminel de guerre nazi, haut fonctionnaire du Troisième Reich et officier SS qui a notamment organisé l’identification des victimes de l’extermination raciale, principalement dirigée contre les Juifs, et leur déportation vers les camps de concentration et d’extermination.
Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :
ARTICLE SUIVANT :