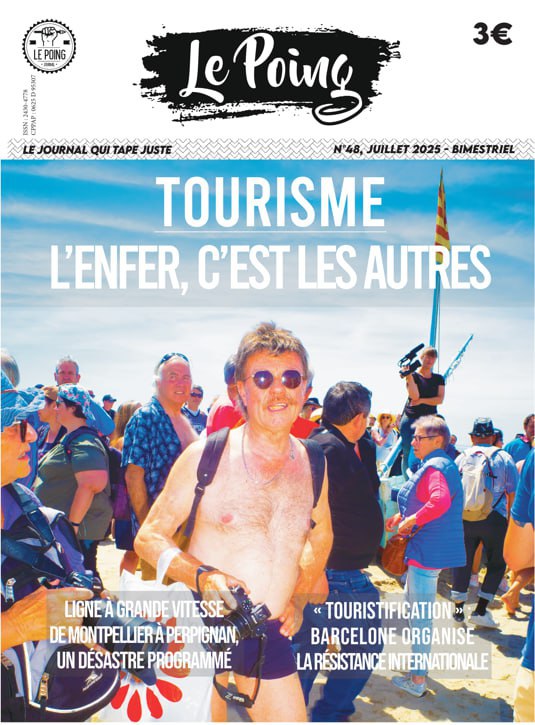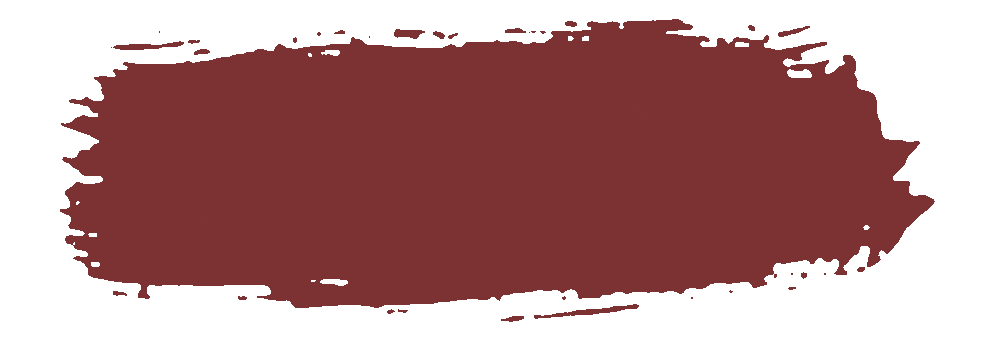Chronique ” Gaza Urgence Déplacé.e.s”| L’accord de Trump pour Gaza
5 octobre 2025Abu Amir envoie ce texte le jour des “pourparlers indirects” au Caire: l’accord de Trump pour arrêter la guerre à Gaza – entre menaces et réserves-
Dans un moment chargé de tension et de sang, une nouvelle initiative a émergé de Washington, portée par la voix du président américain Trump, revenu sur la scène internationale avec un discours rappelant son style controversé. L’accord n’a pas été présenté comme une option diplomatique ordinaire, mais plutôt comme un « ultimatum » ressemblant à une déclaration militaire : une heure précise, un délai court, une menace explicite d’un enfer sans précédent si la signature n’avait pas lieu.
Ce ton a immédiatement jeté son ombre sur la scène de Gaza, où les habitants considèrent chaque nouvelle politique comme un bulletin météo déterminant si le lendemain passera en paix ou sous les bombardements. Il ne s’agissait pas de simples détails de négociation, mais d’une véritable course contre la montre entre obus tombant du ciel et un espoir trébuchant de renaître sous les décombres.
L’accord promu par Trump comprenait une vingtaine de clauses, couvrant des aspects humanitaires, politiques et sécuritaires. La plus importante de ces dispositions est un cessez-le-feu total, une exigence primordiale et urgente pour les habitants de Gaza, épuisés par des années de siège et de bombardements.
Mais le plan ne s’arrêtait pas là. Il prévoyait aussi un échange complet de prisonniers et de dépouilles, une question extrêmement sensible pour les deux parties, touchant un dossier historique complexe mêlant considérations sécuritaires et dimensions humaines.
De plus, l’initiative proposait la création d’une autorité transitoire pour gérer la bande de Gaza, présidée par un conseil international dirigé par Trump lui-même, avec des personnalités comme Tony Blair – une tentative de donner une dimension « internationale » à la gestion de Gaza. Ce point a suscité de vives polémiques, puisqu’il plaçait l’avenir du territoire davantage entre les mains d’un organe extérieur que d’une entité locale.
Autre clause controversée : le « désarmement du Hamas », une vieille revendication israélienne réintroduite dans le cadre d’un accord contre des retraits israéliens « progressifs ». Cette seule disposition suffirait à déclencher de longs débats politiques, car elle touche au cœur de l’existence du mouvement et à sa capacité de dissuasion.
Hamas n’a pas fermé la porte, mais ne l’a pas ouverte entièrement non plus. Sa réponse a pris la forme d’une « acceptation partielle conditionnelle » maintenant ouverte la voie aux négociations. Le mouvement a ainsi annoncé son accord de principe pour libérer tous les prisonniers israéliens, vivants ou morts, en échange d’un accord global. Il a également manifesté sa disposition à confier la gestion de Gaza à une autorité technocratique palestinienne soutenue par les pays arabes et musulmans – une manière de montrer une certaine flexibilité face à la communauté internationale.
Mais dans le même temps, Hamas a dressé une liste de huit réserves majeures. Celles-ci n’étaient pas symboliques, mais substantielles, touchant l’essence même de l’accord : absence de calendrier clair pour le retrait israélien, rejet de l’idée d’un conseil international présidé par Trump et Blair, refus du délai trop court pour la remise des prisonniers et des dépouilles. Plus important encore, le mouvement a affirmé que la question du désarmement ne pouvait être réduite à une clause écrite : il s’agit d’une question existentielle, de vie ou de mort. Cette position traduit la conscience du Hamas quant au poids de cette exigence, perçue davantage comme une reddition que comme un compromis équilibré.
En Israël, l’accueil a été positif et rapide. Le gouvernement a exprimé son soutien public au plan, ce qui s’est immédiatement reflété dans son discours politique interne, voyant là une opportunité d’atténuer la pression internationale croissante. Des rapports hébreux ont indiqué que l’armée israélienne avait réduit l’intensité de ses opérations, adoptant une posture « défensive » – signe d’une réponse aux pressions américaines. Ce changement, même relatif, montre qu’Israël prend le plan au sérieux, surtout car il bénéficie d’un parrainage américain direct. Mais une question demeure : cet engagement israélien sera-t-il stratégique et durable, ou seulement une manœuvre politique temporaire pour franchir la première étape de l’accord ?
À Gaza, cependant, la population perçoit l’initiative d’un tout autre angle. Les habitants, qui survivent au milieu des ruines, se soucient peu des « conseils internationaux » ou des noms de politiciens. Ce qui compte pour eux, c’est que les bombardements cessent, que les points de passage s’ouvrent, et qu’ils puissent atteindre l’hôpital sans passer par une table de négociations. Dans les camps, une phrase revient sur toutes les lèvres : « Nous voulons rentrer chez nous, même si ce ne sont que des murs détruits. » Cette aspiration montre que les priorités humanitaires dépassent largement le langage politique. Pour eux, tout accord qui ne garantit pas la libre circulation de l’aide et l’arrêt des bombardements n’est que de l’encre sur du papier. En d’autres termes, Gaza recherche une « vie normale » plus qu’une « formule de gouvernance transitoire ». C’est pourquoi, malgré un accueil favorable à toute trêve, l’opinion publique reste sceptique quant à la viabilité des grands accords s’ils ne se traduisent pas par une amélioration immédiate de leur quotidien.
Les médiateurs arabes et régionaux ont joué un rôle central dès le premier instant. L’Égypte, le Qatar et la Turquie ont multiplié les contacts pour convaincre le Hamas d’adopter une certaine souplesse, soulignant que cette fois-ci l’opportunité était exceptionnelle, et qu’il fallait la saisir pour éviter davantage de victimes. Mais cette pression n’était pas exempte d’inquiétudes : certains ont mis en garde contre le risque que toute modification israélienne du plan ne le vide de son contenu. Là réside le dilemme : comment formuler un accord équilibrant les garanties demandées au Hamas avec des engagements réels de la part d’Israël ?
Sur le terrain, des signaux ont commencé à apparaître. Dans les heures suivant l’initiative de Trump, l’intensité des bombardements a légèrement diminué, mais non sans violations ayant coûté des vies civiles. Cette contradiction illustre le décalage entre les évolutions politiques et leur traduction militaire, la langue des armes retardant toujours celle des déclarations. Fait notable : Trump a adressé un appel public à Israël lui demandant de « cesser immédiatement les bombardements », pour soutenir sa trajectoire politique. Cet appel représente un tournant rare dans un discours américain traditionnellement aligné sur Israël, ce qui a donné à beaucoup le sentiment d’une démarche plus sérieuse que les précédentes.
Malgré ses ornements diplomatiques, l’initiative ressemblait davantage à un « ultimatum politique américain » qu’à un accord équilibré. Elle imposait une liste de demandes lourdes au Hamas, contre des engagements israéliens vagues comme des « retraits progressifs » sans calendrier précis.
Cependant, l’acceptation partielle du Hamas et son ouverture aux négociations signifient qu’il existe un espace pour des ajustements. Si les médiateurs réussissent à transformer les clauses générales en calendriers précis et contraignants, l’initiative pourrait devenir un point de départ d’un nouveau processus politique – aussi fragile soit-il à ses débuts.
Probabilités de succès: Les perspectives sont contrastées :
-
Facteurs favorables : une pression américaine directe sans précédent, un consensus arabe sur la nécessité de la trêve, et une disposition initiale du Hamas à accepter une partie du plan.
-
Facteurs menaçants : l’ambiguïté du désarmement, le rejet du conseil international, l’absence de garanties écrites, et la méfiance historique entre les parties.
L’accord n’est donc pas un « règlement final », mais plutôt un « début de processus » susceptible de s’effondrer s’il n’est pas soutenu par des mesures concrètes et tangibles.
À mon avis, l’accord mélange opportunité politique et langage de chantage. C’est une opportunité, car il propose pour la première fois un cessez-le-feu total et un accès libre à l’aide. Mais c’est aussi du chantage, car il a été imposé avec un délai très court et une menace claire.
Les habitants de Gaza, à travers leurs voix quotidiennes, se préoccupent peu des délais américains ou des conseils internationaux. Ce qu’ils veulent, c’est l’ouverture d’un passage ou la garantie qu’une ambulance parvienne aux blessés. Si cet accord ne se traduit pas par des résultats concrets, il restera une page de plus dans le registre des initiatives mortes-nées. L’accord de Trump est donc le reflet de la situation actuelle : une puissance américaine agissant par le langage de la menace, un mouvement de résistance posant ses conditions prudemment, Israël agitant une réponse partielle, et des médiateurs arabes poussant pour consolider une trêve susceptible de sauver des vies. Mais le véritable succès de cette initiative dépendra de la capacité des parties à transformer la menace en calendrier contraignant et la tutelle en garantie internationale équilibrée.
En attendant, Gaza continue de vivre sous le poids de ” l’horaire de 18H” fixée par Trump, comme une sonnerie libérant des enfants de l’école – mais cette fois, vers des rues sans maisons.
Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :
ARTICLE AGORA SUIVANT :