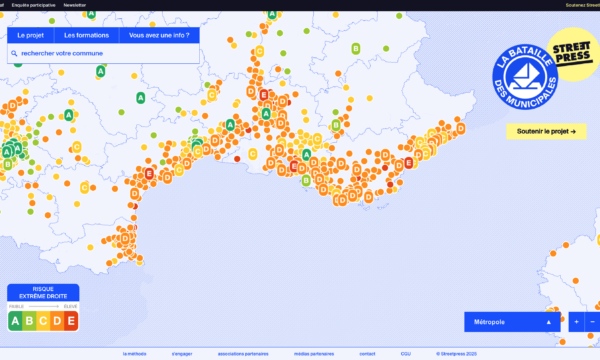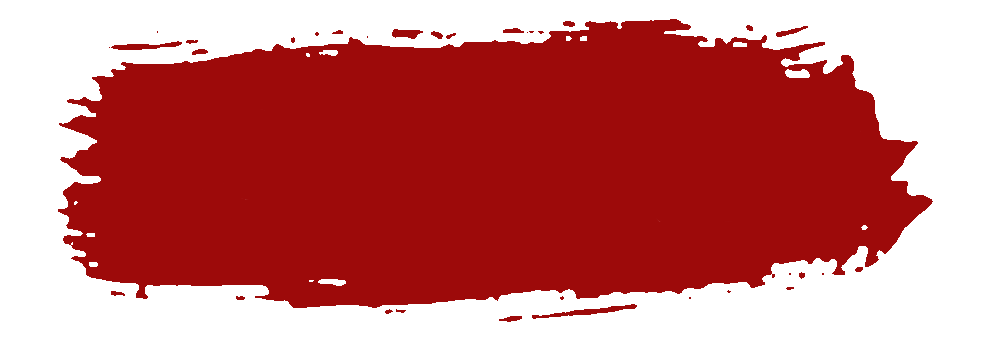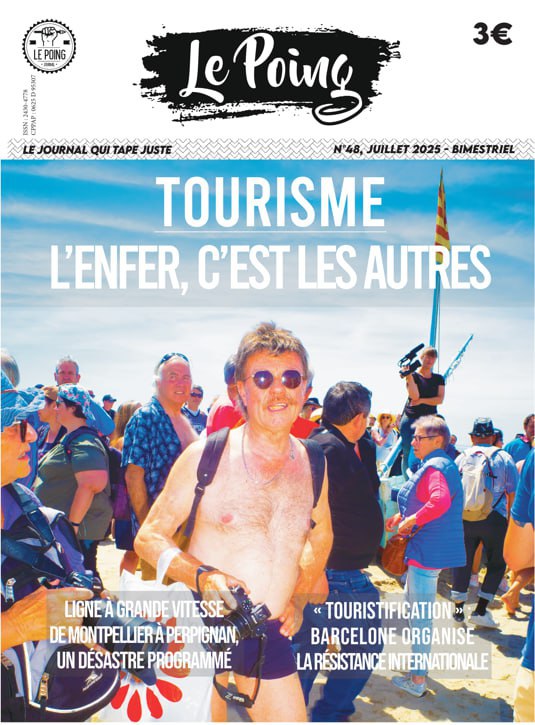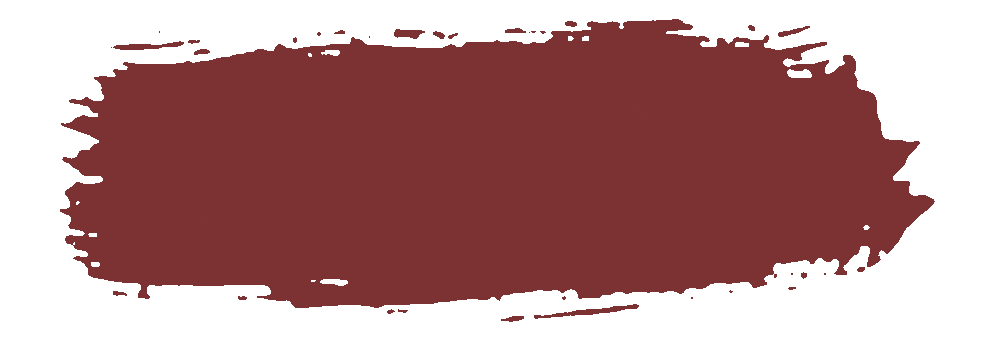LGV Montpellier-Perpignan : « Quand est-ce qu’on fait une ZAD ? »

Vieux projet de la fin des années 1980, la ligne ferroviaire Montpellier -Perpignan arrive à grande vitesse, avec un début des travaux prévu en 2029 pour une mise en service en 2034. L’ampleur du chantier a de quoi mettre les militant·es écologistes sur les rails de la contestation pendant une bonne décennie
Article initialement paru dans le numéro 48 du Poing, publié en juillet 2025, toujours disponible sur notre boutique en ligne.
Iels étaient une trentaine, le 22 mai, à Poussan, à l’initiative du groupe militant de la Coopérative intégrale du bassin de Thau (CIBT), pour la projection d’un film sur la lutte contre l’autoroute A69. De quoi donner des perspectives de mobilisation pour les militant·es présent·es, opposé·es à un projet de ligne à grande vitesse (LGV) entre Perpignan et Montpellier. « Quand est-ce qu’on fait une ZAD ? », s’interroge-t-on dans l’assistance.
Le chantier, confié à la SNCF, est titanesque : une nouvelle ligne ferroviaireà 330 km/h de 150 km longeant la ligne actuelle (plus 30 km de raccordement), traversant 23 communes entre Montpellier et Perpignan, impliquant,entre autres, d’ériger un viaduc de près de 30 mètres de haut et d’1,4 km de long aux abords de l’Étang de Thau, de creuser un tunnel sous le massif de la Gardiole et de créer deux nouvelles gares TGV, à Béziers et Narbonne. Le tout pour la modique somme de 6,2 milliards d’euros, financés à 40 % par l’État, 40 % par les collectivités territoriales et 20 % par l’Union européenne, dans le cadre d’un corridor ferroviaire méditerranéen reliant Budapest au sud de l’Espagne.
Les gouvernants, à commencer par Carole Delga, la présidente PS de la Région Occitanie, déjà fervente partisane de l’autoroute A69, défendent un projet reconnu d’intérêt général, qui permettra de réduire les temps de parcours entre les grandes villes occitanes et les métropoles, la ligne actuelle entre Montpellier et Perpignan n’étant pas à grande vitesse. « À titre d’exemple, Paris sera désormais accessible depuis Perpignan en 4h20 contre 5h10 aujourd’hui », précise la SNCF. Un gain de temps pas exceptionnel et pourrait être encore moindre, selon un rapport de 2022 de France Nature Environnement, qui souligne une « absence de prise en considération du temps d’accès aux nouvelles gares, notamment en transports en commun : les accès aux gares situées en dehors des villes étant négligés, le dossier ne prend en compte que les gains de temps pendant le trajet en TGV et donc présente un bilan socio-économique positif fallacieux ».
La « ligne nouvelle Montpellier – Perpignan » (LNMP) représente surtout le dernier chaînon manquant entre la France et l’Espagne, et plus largement sur le corridor Budapest – Madrid, la ligne à grande vitesse actuelle s’arrêtant, en provenance de Paris, à Montpellier et, en provenance de l’Espagne, à Perpignan.

Issanka, Florensac, Bessan : des points sensibles sous les rails
« Avec ce projet de LGV, plus d’une quinzaine de captages d’eau seront impactés », dénonçait une militante de la CIBT, lors d’une manifestation pour la ressource en eau à Montpellier, le 24 mai. Le collectif Alerte LGV Thau, qui s’est réuni le 13 juin à Loupian, alerte notamment sur la construction du viaduc de la Vène, dont les « piliers seraient implantés directement dans la zone du captage principal d’Issanka, [qui] alimente en eau Sète et de nombreuses communes du bassin ».
« Des pylônes seraient enterrés à 15 mètres de profondeur, alors que la nappe phréatique n’est qu’à 20 mètres », précise la militante de la CIBT. « Le projet ne verra pas le jour sur Issanka s’il y a un impact sur la ressource en eau », a promis Stéphane Lubrano, directeur de la mission LNMP SNCF, en novembre 2024, lors d’une réunion publique à Poussan qui a déraillé face à la contestation des habitants. Une affirmation qui lui sera sans doute rappelée.
L’Autorité environnementale confirme, dans un avis publié en janvier 2025, que « concernant la qualité des eaux, superficielles ou souterraines, le principal risque est celui de pollution » et que, concernant le cas d’Issanka, « les travaux préparatoires sont renvoyés à une autorisation ultérieure », en mentionnant d’autres points sensibles « dans les périmètres de protection rapprochée de captage de Florensac et Bessan ».
Parmi les « principaux enjeux environnementaux » relevés par l’Autorité environnementale figure aussi le « risque d’inondation », alors que, selon nos informations, lors de réunions publiques de ces dernières années, les porteurs du projet le défendaient notamment au motif que la ligne actuelle était menacée de submersion…
240 ans pour compenser la pollution
Malgré les 2 650 hectares consommés par le projet, selon l’Autorité environnementale, la Région Occitanie développe tout de même des arguments écologiques : « La mise en service de la ligne va […] permettre de décongestionner la ligne actuelle, sur laquelle les trains régionaux pourront monter en puissance pour faciliter les mobilités du quotidien, peu chères et décarbonées. […] Autre avantage […] : elle pourra accueillir à la fois des TGV et des trains de marchandises. L’infrastructure réduira ainsi de façon significative la circulation des poids lourds sur les routes et autoroutes, et contribuera à améliorer la qualité de l’air. »
Mais dans sa réponse à l’enquête publique, France Nature Environnement, pourtant très favorable au fret, notait en 2022 que « le dossier ne témoigne pas d’une ambition en matière de transfert modal pour le fret à la hauteur des besoins de décarbonation des transports de marchandises », constatant que « dans le bilan socio-économique, le fret compte quasiment pour zéro ». L’Autorité environnementale a jeté un pavé dans la mare en comparant, dans son avis de 2021, les gaz à effet de serre émis par les travaux aux émissions compensées par le fret et la modification de la répartition des modes de transport des voyageurs : « Il faudra à ce rythme 240 ans pour les compenser ».
Un chiffre contesté par la SNCF, qui table sur un « équilibre entre émissions du chantier et émissions évitées au bout de 35 ans d’exploitation (soit environ un tiers de la durée de vie estimée de l’infrastructure) ».
Même le Conseil national de protection de la nature, rattaché au Ministère de la Transition écologique, a rendu en février 2025 un avis consultatif défavorable, dénonçant un « temps de retour carbone de ce projet […] incompatible avec l’objectif zéro émission nette à l’horizon 2050 ».
Natura 0
Des sites classés Natura 2000 sont concernés par le projet, dont des zones spéciales de conservation et des zones de protection spéciales, ainsi que des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique.Ce tracé quasi rectiligne fera l’effet d’un bulldozer sur les paysages héraultais, défigurant le Massif de la Gardiole, déjà balafré par l’A9, et l’étang de Thau, pour ne citer qu’eux, et entraînera « une fragmentation élevée de nombreux espaces », selon le Conseil national de protection de la nature.
En effet, la ligne LGV agirait comme une barrière infranchissable et de nombreuses espèces finiraient par s’éteindre faute de pouvoir se rencontrer et se reproduire. Le collectif Alerte LGV Thau compte 800 espèces impactées, dont l’outarde canepetière, un oiseau menacé devenu le symbole des luttes contre les méga-bassines. En théorie, il faut un avis ministériel pour détruire l’habitat d’une espèce protégée. Dans la pratique, on peut déroger à la règle en prévoyant des compensations.
C’est le fameux principe : éviter-réduire-compenser, qui laisse entendre qu’on pourrait détruire un habitat naturel tant qu’on crée des jolies petites mares un peu plus loin.« Comment vous pouvez compenser la perte de ressources en eau ou en biodiversité ? C’est une illusion de technocrate ! », tranche un militant d’Alerte LGV Thau.
La compensation écologique entretient l’illusion que tout peut se remplacer, alors que nous savons désormais que certains écosystèmes, une fois disparus, sont impossibles à régénérer, avec des conséquences souvent mal connues. C’est aussi une manière de se déresponsabiliser, en promettant qu’on fera mieux, promis, mais plus tard.
Un réseau existant sous-évalué
Les militant·es de la CIBT dénoncent un projet vieux de trente ans sans lien avec les besoins réels de la population. Pour elleux, l’argument de la saturation du réseau existant ne tient pas : « 45 trains circulent par jour sur le tronçon Montpellier – Narbonne alors que la norme de tracé horaire permettrait d’en faire circuler plus de 200 ».
D’une manière générale, le réseau ferroviaire français ne semble pas saturé : l’Autorité de régulation des transports compte 26 000 km de lignes ferroviaires pour 15 000 trains par jour, selon la SNCF, soit 0,57 train par km de réseau, contre 1,9 pour la Suisse et 1 pour la Belgique, à titre de comparaison, sur des réseaux pourtant bien plus petits.
Daniel Ibanez, auteur du livre Trafics en tous genres, le projet Lyon-Turin (éditions Tim Buctu, 2014), balaie aussi l’argument économique. « Le premier maillon du grand projet européen consistant à relier les métropoles entre elles, c’était la liaison Perpignan-Figueras. Elle a été mise en service en 2010 et dès 2014 elle a fait faillite, avec seulement 8 % du fret escompté, et 15 % des voyageurs prévus, [et la gestion, déficitaire, a donc été reprise en main par les États français et espagnol, ndlr].Il faut avant tout se poser la question de l’utilisation des nouvelles lignes ferroviaires, et mieux exploiter le réseau existant. L’État doit rendre des comptes : on n’a aucun résultat, aucun bilan publié sur les investissements passés dans le ferroviaire, alors que la loi d’orientation des transports intérieurs de 1982 imposait des évaluations publiées au plus tard cinq ans après la mise en service des grandes infrastructures de transport, ce qui n’est quasiment jamais fait. »
Si les deux collectifs engagés contre le projet, Alerte LGV Thau et la CIBT, partagent le diagnostic, ils se distinguent par les moyens d’action. Le premier privilégie la négociation pour proposer un autre tracé qui épouserait mieux le territoire, préserverait les zones sensibles et serait moins coûteux, pour privilégier l’investissement dans les transports de proximité tandis que la CIBT, anticapitaliste, ne veut pas de cette LGV, ni ici, ni ailleurs, et dénonce un « imaginaire mortifère de croissance infinie ».
Contactée, la Région Occitanie n’a pas donné suite à nos sollicitations.
Elisa Chavent
Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :
ARTICLE SUIVANT :