La Toma : récit argentin d’une victoire ouvrière
Ceci est une histoire aussi vraie que pourrait l’être le récit d’un conteur. Elle a été inspirée de l’histoire du documentaire The Take de Naomi Klein, du film Industria Nacional de Ricardo Diaz Lacoponi, des entretiens réalisés auprès de dizaines d’ouvriers autogestionnaires à Buenos Aires, des travaux des sociologues Andrés Ruggeri et Maxime Quijoux, et de mon irrésistible envie de voir un jour la démocratie populaire triompher sur le capitalisme.
Nous étions tous là, une quarantaine de travailleurs menés à bout. L’assemblée clandestine avait été décidée la veille, et pourtant chacun d’entre nous avait tout de même pu se rendre chez Roberto, l’ancien de l’usine. Nous ressentions tous cette chaleur moite si caractéristique des nuits d’été de Buenos Aires. La capitale fédérale de l’Argentine porte très mal son nom. L’air ne circule pas et aucune brise ne vient soulager ses habitants lors des nuits comme celles-ci. Il est impossible de trouver le sommeil dans ces conditions. Cela importait peu ce soir là. Parmi les assistants à cette réunion inédite dans le patio de l’humble demeure de Roberto, située au sud de la ville, il ne s’en trouvait pas un qui eut l’intention de dormir. Notre futur et celui de nos familles était en jeu. Les braises de la parrilla(1) étaient encore fumantes et je m’affairais à les éteindre lorsque Juan Carlos Larreta, que nous sur- nommions affectueusement El Maestro prit la parole :
« Muchachos, on a tous bien mangé non ? Pour ma part ça fait des mois que je ne vais pas chez le boucher », dit-il avec une lueur d’angoisse dans son regard. Nous savions tous de quoi il parlait, cela faisait quelque temps que nous nous serrions la ceinture. Cette lueur disparût aussitôt, et levant son verre il ajouta d’une voix calme et déterminée : « Salud compañeros, hasta la victoria siempre ». « Salud Maestro ! » Nous répondîmes à l’unisson. La session était ouverte, et nous allions pouvoir nous mettre à discuter de notre plan d’action.
L’année 2002 avait été terrible. Faute de demande, la production de notre usine avait chuté, en provoquant une série de crises successives dans notre collectif de travailleurs. Nous fabriquions des pièces détachées pour automobiles. De la bonne industrie nationale, celle dont l’âge d’or ne se retrouvait plus que dans les récits de nos aïeux, dont Juan Carlos faisait partie. Notre ancien patron, un homme d’une cinquantaine d’années, petit et trapu, avait au moins un avantage pour lui, il savait faire les calculs. En tout cas bien plus rapidement que nous. Il avait même un talent particulier pour calculer ses marges de bénéfices, et ce, bien mieux que les mois de salaires qu’il nous devait. La seule évocation de ce sujet suffisait à le mettre hors de soi l Il nous disait, sa cigarette à la bouche et son regard acéré : « Les gars, les clients n’achètent pas en ce moment, c’est dur pour tout le monde, ne soyez pas égoïstes carajo(2) ! Soyez patients ! ». Nous étions donc des égoïstes ? Certains d’entre nous se mirent à le croire. Demander un salaire en échange du travail fourni devait être en effet inadmissible. Cette situation s’étendant sur des semaines, nous n’avions plus accès qu’à l’expert comptable pour réclamer nos salaires, notre source de vie dans un monde où notre survie pure et simple dépend de la quantité de monnaie en notre possession. Nous avions cependant gardé un certain espoir, en nous répétant que les ventes allaient certainement repartir à la hausse et notre usine sortirait de la zone dangereuse. Je me souviens encore de ce que je ressentis le jour où la vérité avait éclaté au grand jour. C’était une désagréable sensation de vide, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Un courant glacé avait parcouru mon épine dorsale tout en me coupant le souffle. Comme tous les matins, je m’étais douché et rasé, j’avais pris le petit déjeuner composé d’une tasse de mate cocido(3) et d’une tartine de dulce de leche
(4), Aux côtés de mon épouse Rocio et de ma fille que nous avions nommé Esmeralda. J’avais attendu le bus, qui était arrivé en retard comme d’habitude, et après une heure de trajet je m’étais retrouvé face à l’imposant portail métallique de mon usine. Fermé. Avec pour seule explication une feuille de papier scotchée à la porte de service portant l’inscription suivante : « L’usine sera fermée temporairement. Nous vous rappellerons lorsque la production reprendra. La direction ».
Nous avions hypothéqué des mois de salaire en nous privant de tout, et à présent notre seul espoir de sortir du gouffre venait d’être achevé par ces quelques mots. On s’était fait rouler comme des enfants, comme des honnêtes gens que nous sommes, qui ne connaissaient jusqu’alors que le travail servile comme mode de vie. Nous avions tout accepté et voilà que nous nous retrouvions à la rue, sans préavis.
Les réactions à ce moment là avaient été diverses parmi les camarades assemblés devant ce qui avait été jusqu’à la veille le centre de gravité de nos vies. Certains avaient fondu en larmes, d’autres étaient partis en silence, le regard perdu. Mais une lente ébullition commençait à prendre place dans le cer- veau de la plupart d’entre nous.
Derrière la porte se trouvaient les vieilles machines qui jusqu’à la veille ronronnaient au contact de nos mains engantées, dont nous connaissions la signification de la moindre vibration, nous savions prévoir et réparer n’importe quelle panne. Il faut dire que celles-ci avaient été de plus en plus fréquentes ces dernières années, et ces derniers mois l’usine ne fonctionnait que grâce à notre savoir faire. Le patron avait cessé d’investir dans les machines et avait laissé la situation se dégrader. Avant la crise le navire restait à flot, mais à ce moment là c’était nous qui payions la politique patronale du profit maximum à court terme, ainsi que la politique économique du pays qui avait réduit à l’humiliation des millions de travailleurs comme nous, contraints de devoir mendier un semblant de rémunération à leur patron. Le désespoir n’avait duré que quelques minutes. Il fallait agir, et vite. Il restait à définir comment. Les gars se mettaient à parler de tribunaux, d’indemnités, chacun connaissant quelqu’un qui connaissait peut être un avocat qui selon ce qu’on avait ouï dire pourrait éventuellement… Enfin bon, passons. Le chômage atteignait le seuil historique des 50%, nous n’étions pas en position de force nous, les travailleurs. Il ne fallait pas compter sur les indemnités. Face à tant de propos qui m’avaient semblé irréalisables j’avais regagné mon quartier sans toutefois me décider à rentrer chez moi, afin d’éviter d’annoncer la triste nouvelle à mon épouse. Le soir même de cette affreuse journée, la sonnerie du téléphone avait interrompu notre dîner. Le comptable me proposait de reprendre le boulot dès la semaine suivante avec une équipe réduite. La vitesse de la réaction patronale me prenait de court à ce moment là. Nous n’avions pas eu le temps de nous organiser, je ne savais pas si nous allions entreprendre une action tous ensemble. J’ignorais comment allaient réagir mes camarades. Accepter ce poste immédiatement en revenait à desserrer l’étau qui étouffait mon foyer, mais cela signifiait aussi de le resserrer jusqu’à l’asphyxie pour les camarades qui ne seraient pas appelés. Si nous reprenions le boulot avec les quelques élus, le patron se passerait des autres définitivement. Etais-je capable de les trahir comme ça ? Mais si j’en parlais à tout le groupe, je condamnais peut être les chances de survie de « l’équipe réduite ».
Je me souviens d’avoir bredouillé une réponse positive pour gagner du temps.

Le patron commettait toutefois une erreur de stratégie fondamentale en nous faisant attendre quelques jours pour reprendre le travail. Nous avions de notre côté la force du nombre. Néanmoins cet atout comporte en lui une faiblesse intrinsèque que les puissants ont toujours réussi à exploiter en leur faveur : la difficulté qu’a la majorité pour s’auto-organiser. Il fallait remédier à cela. Juan Carlos, le vieux prof du quartier, notre Maestro, l’homme du bon conseil, celui dont on ne savait pas grand-chose hormis le fait qu’il en savait beaucoup, était toujours prêt à donner un coup de main à des gars en galère comme nous. Il avait naturellement accepté d’assister à notre assemblée, la première d’une longue série, de manière à ce que la seule évocation de sa présence ait garanti l’assistance de tous les camarades.
Il se tenait donc là parmi nous, au fond du patio de chez Roberto, avec son expression déterminée de laquelle émanait une irrépressible et contagieuse lueur d’optimisme. Sachant ce qu’on attendait de lui il reprit la parole. L’histoire qu’il se mit à nous raconter nous surprit tous. Je me souviens de ne pas avoir compris d’emblée où il venait en venir.
« Vous savez muchachos, il y a quelques années, avant que la crise éclate pour de bon, j’ai connu un homme qui a changé ma façon de voir le monde. Il était plus âgé que moi. Oui, c’est possible, ne rigole pas toi au fond », dit-il en pointant amicalement du doigt le plus jeune d’entre nous, Pedro, que nous surnommions Pedrito. « Cet homme, reprit El Maestro, était le guichetier de l’ancienne gare de Villa Teresita, vous connaissez ? Non, évidemment, presque plus personne ne vit à Villa Teresita depuis au moins dix ans. Le démantèlement du réseau ferroviaire national a démantelé aussi des vies, des postes de travail, et a fait disparaître des villages comme celui dont je vous parle. Quand j’ai connu cet homme, Villa Teresita était en pleine décadence, la gare avait déjà fermé depuis deux ans faute de train, et ce brave type était licencié. Mais il était encore en uniforme. » Le ton de Juan Carlos Larreta se fit plus intense. « Il était en uniforme les gars, continua-t-il, vous comprenez ? » Nous ne comprenions évidemment pas. El Maestro fit une pause. Il avait captivé l’assemblée en quelques minutes, une fois de plus. « Et il balayait le perron de la vieille gare, continua-t-il solennellement. Je lui ai demandé pourquoi il faisait ça. Et il m’a répondu : ‘‘Parce que c’est mon travail, j’ai fait ça toute ma vie, c’est notre gare à nous, les gens de Villa Teresita, il faut qu’elle soit belle, il faut qu’elle soit propre’’. J’ai appris récemment que ce vieil homme est décédé depuis peu, mais il a tenu à s’occuper de la vieille gare jusqu’à son dernier jour. » Juan Carlos but une gorgée de vin rouge du verre qu’il tenait à la main. Pendant ce laps de temps le silence qui s’était installé parmi nous n’était nuancé que par le crépitement des quelques braises encore incandescentes et par les bruits de circulation au loin, qui arrivaient jusqu’à nous en perçant la chaleur écrasante de cette nuit étoilée. Juan Carlos reprit la parole. S’il ne l’avait pas fait, je pense que nous serions encore en train d’attendre la suite de son récit, car à ce moment là je peux jurer qu’aucun d’entre nous n’aurait osé prononcer un mot.
« Que signifie cela les gars ? Pourquoi cet homme a continué à prendre soin de son lieu de travail après qu’on l’ait viré comme un chien ? Il ne percevait plus aucun salaire après ça, je suppose qu’il s’était trouvé una changuita(5) mais allez savoir. Ce qui importe dans cette histoire est que l’action de cet homme vue à travers le prisme de la logique économique est de la pure folie. Mais c’est cette folie même qui est la preuve à mes yeux qu’autre chose existe chez nous, les humains. On ne vend pas notre travail en échange d’un salaire. Nous ne sommes pas des mercenaires. Cet homme est bien la preuve que nous ne sommes pas des machines rationnelles ! D’autres liens nous guident, d’autres moteurs nous animent. Qui n’a pas appris à aimer sa machine ? Je suis sûr que vous pourriez piloter la votre les yeux fermés. La plupart d’entre nous acquiesçâmes. Qui n’a pas éprouvé du plaisir, oui du plaisir les amis, à fabriquer une pièce le plus parfaitement possible ? Mais personne n’a jamais reconnu cet art que vous avez appris à développer n’est-ce pas ? Mais il y a mieux. Vous n’avez pas produit uniquement des pièces de voiture. Vous avez produit quelque chose de bien plus puissant, et cette chose est presque palpable. Elle se trouve ici même parmi nous. »
Nous échangeâmes des regards curieux, el gordo Marcelo jeta un coup d’oeil aux restes de la grillade, mais la réponse ne se trouvait pas là pour une fois. Le jeune Pedrito brisa le silence et demanda :
« Le lien, n’est-ce pas Maestro ? » Un sourire triomphal se dessina sur le visage du vieil homme.
– Exactement, répondit-il. Et ce lien va être mis à l’épreuve dans très peu de temps. Votre camarade Walter Ventura a quelque chose à vous dire. »
Toute l’assemblée posa ses yeux sur moi. Je vidai mon verre d’un trait et me levai. J’avais plus ou moins préparé ce que je devais dire, mais le moment de l’action est toujours plus intense que le calme de ma petite salle de bain. Je racontai la proposition qui m’avait été faite, et bien que je me doutais de l’identité de ceux qui avaient reçu une proposition analogue, je ne prononçai leur nom à aucun moment. Les cinq visages que j’avais en tête se tenaient côte à côte, quelque peu en retrait. Ils me dévisagèrent mais ma décision était irrévocable. Il fallait que j’informe le groupe. Et je le fis.
Lorsque j’eus fini mon récit la plupart de mes camarades étaient scandalisés, mais avant que leur indignation dégénère en conflit, el Maestro, qui avait appris à gérer les temps d’une discussion d’une façon magistrale s’imposa de sa voix grave et usée par le temps. Il nous expliqua qu’il avait assisté à ce processus plus d’une fois, que le patron voulait faire bosser les quelques privilégiés – son ton se chargea d’ironie lorsqu’il prononça ce mot – pour honorer ses dernières commandes, et puis il viderait l’usine de ses machines. Il expliqua également que s’il s’agissait de commandes de pièces très précises, il n’attendrait pas que le petit groupe ait fini de les produire pour retirer les machines qui n’interviendraient pas dans le processus de production. Ensuite il pourrait se passer de tout le monde. « Pourquoi il ferait ça ? demanda naïvement el gordo, qui pour une fois avait toute son attention concentrée sur autre chose que la nourriture. – Parce qu’il est endetté jusqu’au cou, répondit Juan Carlos Larreta. Il est endetté auprès de vous, puisqu’il ne vous paye plus vos salaires, vous pouvez être certains qu’il n’a pas payé vos apports sociaux, et il est logiquement endetté envers ses fournisseurs et envers l’Etat… Je serais étonné qu’il ait réglé ses factures de gaz et d’électricité. S’il se fait saisir les machines il est foutu, il va soit les vendre, soit les placer dans une autre usine. Mais ce qui est sûr les amis, c’est que vous allez vous retrouver sans rien. Il doit disparaître et laisser l’usine à l’abandon, les créanciers pourront toujours courir pour se faire payer. C’est possible qu’il n’attende pas la semaine prochaine pour commencer à vider l’usine. » Notre petite assemblée fut parcourue par une sensation de désarroi.
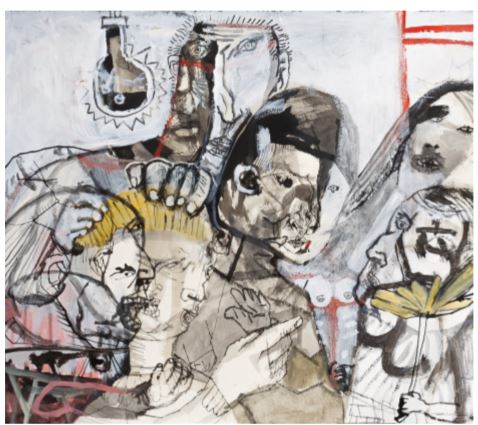
Qu’allions nous faire ? Si le pronostic du Maestro était vrai, nous étions perdus. Je n’avais aucune chance de retrouver du travail ailleurs, pas plus que mes camarades d’ailleurs. Ce fut le moins aimé du groupe qui prit la parole. J’avais toujours estimé qu’il était plus âgé que moi. Surplombant son front dégarni, des cheveux blancs s’étaient mis à se frayer un chemin parmi ses cheveux noirs, invariablement coiffés en arrière. La bataille pour la domination de son cuir chevelu qui se déroulait sur sa tête faisait écho à celle qui devait se dérouler dans son crâne depuis quelque temps. Lorsque je l’ai connu, Mieres était le gars le plus solidaire du groupe. Mais au fil des ans il s’est mis à prendre ses distances vis-à-vis de ses camarades, et à se rapprocher du patron. On raconte qu’il avait cruellement besoin d’argent. Enfin, pour moi et pour bien d’autres c’était le lèche-cul de la direction. Il fit donc naturellement un commentaire qui collait parfaitement avec l’idée que nous avions de lui. « Juan Carlos, tu vas nous proposer d’occuper l’usine c’est ça ? Tu veux qu’on empêche que le patron se tire avec les machines ? Et après ? On va en faire quoi de ces vieilles choses obsolètes ? Il faut qu’on mange nous, il faut qu’on touche nos indemnités, tu penses qu’on va se lancer là dedans ? »
« Le nom d’Eduardo Murua vous dit quelque chose les gars ? demanda-t-il en se dirigeant à l’assemblée après avoir posé un bref regard sur Mieres. C’est le président du Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, le MNER. J’ai déjà eu à faire à lui et il est prêt à vous aider. A l’heure dont je vous parle le MNER a mené avec succès une cinquantaine de luttes comme la votre, et je vais vous dire quelque chose : vous n’avez pas vraiment le choix. Le calcul de Mieres, dit-il en pointant celui-ci du doigt tout en regardant l’assemblée, pourrait être correct dans un pays du Premier Monde, mais ici, avec un travailleur sur deux qui est au chômage vous pensez pouvoir retrouver du boulot ailleurs ? Et pour les indemnités ne vous faites pas d’illusions, si vous les touchez avant de mourir de faim vous les dépenserez en quelques mois – il fit une pause pour reprendre son souffle – et vous vous trouverez dans le même pétrin qu’aujourd’hui. Je ne suis pas plus malin que vous, vous savez ? Mais si je vous dis ça c’est parce que j’ai vu pas mal de choses à mon âge, et croyez moi, si on s’organise, tout devient possible. »
Les paroles du Maestro percutèrent dans l’esprit de mes camarades bien plus rapidement que je ne l’espérais. Mieres ne dit mot. Ce fut une fois de plus Pedrito qui prit la parole et enclencha la dynamique de groupe. Il cria, au risque de réveiller le quartier : « Bon alors on vote pour la reprendre notre usine muchachos ? ».
Mieres se leva, ses traits tendus par une expression de doute et de colère, empêchant ainsi le vote imminent : « Et après les gars ? Je sais ce que vous pensez tous de moi, et je ne veux pas faire l’avocat du diable mais… l’un d’entre vous sait tenir une comptabilité ? Quelqu’un ici a la moindre idée de comment on gère une usine ? Non ! Alors je vous demande, on va faire comment ? Combien de temps on va tenir ? Je sais qu’on est foutus, je ne suis pas plus con qu’un autre, mais… »
– Et les gars d’IMPA, tu crois qu’ils savaient peut- être ? » lui rétorqua Pedrito, sur un ton plus calme, mais suffisamment fort pour que tous les présents l’entendent.
Je doute fortement que Pedrito ait été conscient de ce qu’allait évoquer ce nom au sein de notre assemblée mais je peux assurer qu’il fit un effet immédiat. Nous avions tous entendu parler de l’histoire d’Industria Metalurgica y Plastica Argentina, de la lutte qu’avait mené un groupe d’ouvriers acculés par la menace imminente du chômage et de la misère, et qui faisaient tourner leur usine en autogestion depuis 1998. C’étaient à nos yeux des pionniers qui s’étaient lancés à l’aventure vers un avenir incertain et tumultueux avec leur seul courage en guise de boussole.
« C’est la première usine récupérée du MNER d’ail- leurs, glissa le Maestro, ils savent mener une lutte ces gars là, ajouta-t-il. »
Nous votâmes à main levée. Je ne pense pas que tout le monde ait été convaincu à ce moment là de la décision que nous prîmes, mais ceux qui ne devaient pas l’être s’abstinrent de le montrer. La décision de reprendre l’usine fut approuvée à l’unanimité, si tant est que l’avant bras à demi levé de Mieres, qui devait être en proie à une bataille intérieure d’anthologie, puisse être considéré comme un vote affirmatif. Maintenant, il fallait passer à l’action.

Nous n’attendîmes pas le lendemain pour monter la garde devant l’usine au cas où le patron se lance dans ses manœuvres frauduleuses. Mon groupe de garde attendit toute la nuit tapis dans ma vieille Renault 9 que je mettais à disposition de la manœuvre. Rien ne se passa. L’aube du samedi se levait apportant un semblant de fraîcheur qui ne dura que quelques heures. La grillade de la veille m’avait remonté le moral d’une façon inouïe, ainsi que l’action que nous avions décidé d’entreprendre. Dès que le patron se pointerait, nous empêcherions son camion de repartir en le bloquant avec ma voiture. Entre temps le groupe qui monterait la garde devrait pénétrer dans l’usine et n’en sortir sous aucun prétexte, tout en donnant l’alerte par téléphone aux camarades. Si nous agissions rapidement le tour serait joué. Les événements qui suivraient allaient se charger de mettre en évidence la naïveté de notre stratégie.
La journée du samedi s’écoula sans histoires. Je m’étais porté volontaire pour intégrer également le groupe de garde de la nuit du samedi au dimanche.
Tout se passa très rapidement.
Nous étions en train de nous assoupir lorsque Mieres, qui, contre toute attente s’était lui aussi porté volontaire, se redressa sur son siège. Nous n’entendîmes le vrombissement d’un poids lourd que quelques secondes plus tard. Je fus à deux doigts de mettre le contact mais je me ravisai.
Lorsque le camion se positionna en marche arrière face au portail de l’usine, et que je vis descendre le patron en personne, j’envoyai Pedrito donner l’alerte depuis la cabine téléphonique qui se trouvait à cent mètres derrière nous. Je suis convaincu encore aujourd’hui que si nous avions chronométré sa performance, Usain Bolt ne serait plus l’homme le plus rapide du monde. Nous attendîmes que le patron ouvre le portail, regagne le volant du poids lourd et le fasse pénétrer dans l’usine. Ayant pénétré en marché arrière dans notre usine, le camion dépassait encore d’un mètre et empêchait ainsi de refermer le portail. Profitant de la pente, je fis glisser ma voiture au point mort, le moteur éteint jusqu’à ce que j’eusse bloqué le camion. Pedrito était de retour parmi nous et ne demandait qu’à occuper les lieux, et pourquoi pas mettre une rouste au patron. Mieres, dont toute intervention, pour une rai- son ou une autre appelait à notre modération envers le patron lui dit sèchement : « Attends petit, tu crois qu’il va les porter tout seul les machines ? Il faut voir combien ils sont. Je vais descendre pour… »
M’attendant à une trahison de dernière minute de sa part, je lui emboîtai le pas. Nous étions de retour dans la voiture deux minutes plus tard.
« Alors les gars ? demanda Pedrito tout excité.
– Alors c’est des géants », lui répondis-je avec une touche d’amertume dans ma voix.
Le quatrième passager, Niccolino « El Mudo » Locce, un homme proche de la quarantaine qui avait abandonné sa carrière de boxeur au début des années 1990, portait très bien son surnom : on ne l’entendait jamais dire un mot. On racontait à l’usine qu’il aurait pu devenir le meilleur des poids plumes du pays, mais qu’il avait refusé de se coucher au deuxième round de son dernier combat. Le baron qui contrôlait les paris locaux ne le lui avait pas pardonné, et sa compagne fut retrouvée morte non loin de chez lui, une balle logée dans la nuque. Depuis, il était impossible de lui arracher plus de deux mots d’affilée. Seulement, ce soir là il paraissait quelqu’un d’autre. Nous fumes sidérés de l’entendre demander d’une voix si caverneuse qu’elle ne semblait pas émaner de ce corps d’un mètre soixante-cinq :
« Combien ils sont ?
– Ils… ils sont trois, répondis-je à mi voix, plus le patron.
– Le patron on s’en fout, répondit-il. Mieres, reste dans la bagnole, Ventura (tout le monde m’appelait par mon nom de famille, allez savoir pourquoi), Pedrito, venez avec moi. Mieres, si quelqu’un arrive tu klaxonnes. »
Qu’envisageait El Mudo ? Serait-il possible que le patron attende du monde ? Ces questions restèrent momentanément sans réponse : l’action venait de prendre le pas sur la réflexion. ans que je sache comment, mes jambes me portèrent jusqu’à l’intérieur de l’usine, emboîtant le pas à Niccolino. Pedrito se trouvait juste derrière moi. Le visage du patron, en nous apercevant, se transforma en un rictus qui évoquait plus la peur que la haine. Sans dire mot, les géants qui étaient à sa solde, et qui manifeste- ment étaient préparés à l’éventualité de notre présence, se jetèrent sur nous. Le premier tomba aussitôt KO suite au terrible crochet du gauche que lui asséna Niccolino Locce à la mâchoire. Le bruit que provoqua cette masse s’étalant sur le sol en béton arrêta net la course de ses acolytes. J’étais tout aussi surpris qu’eux suite à ce que je venais de voir, mais cela conférait à notre équipe un avantage moral que nous nous devions d’exploiter au plus vite.
El Mudo, la garde haute, se mit à danser autour du 2e géant qui semblait hésiter à s’approcher de lui, tandis que le troisième fonçait vers nous. Je n’ai jamais été un très bon combattant et je fis honneur ma réputation ce soir l. Je visai un de ces genoux en lançant le coup de pied que je manquai désastreusement. Encore aujourd’hui, j’invoque comme excuse la pénombre qui régnait dans l’usine au moment de l’escarmouche. Cette performance me valut un violent direct en pleine figure, mais je ne tomai pas malgré le choc et la douleur qui se fit sentir quelques dixièmes de secondes après l’impact. Le géant n’eût pas le temps de m’achever. Je m’attendais à recevoir un autre coup de la sorte, mais le bruit sourd que j’entendis ne fit correspondre aucune douleur en ma personne. A la place je vis s’effondrer mon adversaire devant moi. Pedrito se tenait juste derrière lui, un pot d’échappement quelque peu amoché à la main. Hébété, je le regardai dans les yeux. Il leva son arme, qui avait épousé quelque peu la forme du crâne du géant, et me dit en souriant fièrement « industrie nationale, mon pote ».

Nous nous retournâmes vers El Mudo et le troisième géant. Pendant les quelques instants qu’avait duré notre assaut, l’homme du patron s’était décidé à passer à l’attaque. En vain. Aucun de ses coups n’avait atteint ni la tête ni le corps de Locce. Je vis comment notre camarade se baissait avant que le crochet du géant n’atteigne sa tête, puis se redressait pour esquiver un uppercut. Il atteignit de sa main gauche le foie du géant, ce qui eut pour effet de « couper les jambes » à celui-ci. Sans être inconscient, il se retrouva à genoux. Locce baissa sa garde et le regarda. Le regard du géant était chargé de sens. Il reconnaissait sa défaite et s’il en avait eu la force, il n’aurait rien tenté. Il devait s’agir d’un vrai combattant, et apparemment leurs codes ne s’appliquaient pas que sur le ring.
Nous venions de remporter la bataille, mais la joie ne fut que de courte durée. Le patron avait disparu, et je commençai à m’attendre au pire. Mes craintes n’avaient pas fini de prendre forme dans ma tête que j’entendis des coups de klaxon frénétiques, et le bruit de ma voiture qui s’éloignait à toute vitesse. Le son caractéristique de l’accélération n’avait pas encore disparu qu’un bruit de moteur diesel beaucoup plus puissant envahit la scène sonore. Nous nous regardâmes inquiets. Il ne s’agissait pas du camion dans lequel était venu le patron, puisque l’engin se trouvait toujours devant nos yeux, bloquant le portail. Nous entendîmes un crissement de freins, puis le son caractéristique de décompression de l’air comprimé qui accompagne l’arrêt d’un poids lourd. Les portes s’ouvrirent aussitôt et la voix du patron aboyant des ordres et des injures arriva jusqu’à nos oreilles. Nous entendîmes une autre porte s’ouvrir avec un crissement métallique. Il devait s’agir de la porte arrière du camion. Soudain, la nuit se remplit de bruits de bottes sur le trottoir. Ce son me rappelait indirectement les heures les plus sombres de l’Histoire de mon pays.
Notre vieille usine allait être prise d’assaut, et les troupes qui devaient combattre l’envahisseur étaient bien maigres.
« A l’étage ! » chuchotais-je. Le sang qui émanait de ma blessure au sourcil couvrait mon visage, mais fort heureusement il commençait à coaguler. Nous montâmes en silence les vieux escaliers en béton noirci par la crasse accumulée au fil des ans et atteignîmes la salle des machines principale avant que le patron et sa patota(6) n’aperçoivent leurs trois acolytes hors combat. Il lâcha un juron comme nous pouvions évidemment nous y attendre. Ce qui était inattendu, et qui nous glaça le sang, fut la suite de sa phrase : « vous me trouvez ces merdeux et vous me les faites disparaître ». Ce terme a une signification toute particulière en Argentine, où la dernière dictature militaire a fait disparaître plus de trente mille personnes. Ils ne sont pas vivants, mais aux yeux de la loi ils ne sont pas morts non plus. Ils sont simplement disparus. Je pense qu’à ce moment là, j’ai eu la peur de ma vie.
Suite à un claquement, toutes les lumières principales s’allumèrent. Les trois niveaux de l’usine n’offrirent alors plus une seule zone de pénombre qui aurait pu nous sauver la mise. Contrairement aux intrus, nous aurions pu nous déplacer les yeux fermés dans ce bâtiment vétuste que nous connaissions par cœur, mais la manœuvre du patron nous faisait perdre notre principal avantage. Les bottes foulèrent les premières marches de l’escalier, certainement guidées par les gouttes de sang que j’avais perdu, traçant un chemin qui allait les mener… droit vers nous. Il ne restait plus d’échappatoire. Nous étions cachés derrière trois machines, que nous appelions les « tamponneuses ». Munies d’un long manche qui accomplit la fonction d’un levier, elles servent à donner la forme aux pièces selon le moule qu’elles portent. Fort heureusement, nous nous trouvions entre ces machines, et le mur à outils. L’idée vint de Pedrito. En un éclair il se leva, saisit trois marteaux de taille moyenne et nous en remit un à chacun en nous demandant de l’imiter. Les manches des tamponneuses pliaient régulièrement malgré le fait qu’ils soient en acier. Nous devions souvent les retirer pour les redresser à l’aide d’une autre machine, ce qui nous incitait à ne pas respecter toutes les règles de sécurité en faisant en sorte que l’on puisse les enlever facilement. Il suffisait de retirer un écrou dont la vis était si usée qu’elle n’accomplissait plus sa fonction, et le tour était joué. Pedrito fit sauter l’écrou d’un coup de marteau appliqué du bas vers le haut et se saisit du manche en acier de près de deux mètres de long. Nous l’imitâmes aussitôt, juste à temps pour faire face à une douzaine d’hommes vêtus de noir, chaussés de bottes militaires et armés de matraques identiques à celles qu’utilisent encore aujourd’hui les forces de police.
Obéissant à l’injonction de l’un d’entre eux, ils formèrent un demi-cercle autour de nous. Leur discipline était remarquable, il ne devait pas s’agir d’amateurs. Matraques levées, ils s’avancèrent lentement vers nous, réduisant à chaque pas la possibilité de nous échapper en passant entre leurs lignes. Néanmoins je n’avais pas peur. Je ne ressentais pas de la colère non plus, ni l’euphorie caractéristique d’une montée subite d’adrénaline. Ma conscience avait fait abstraction de tout élément qui ne correspondisse à l’immédiateté du présent, ainsi qu’à l’endroit où je me trouvais. Aucune spéculation ne traversait mon esprit. Dans un état de concentration totale, je n’étais que pure réaction.
Lorsque nos assaillants se trouvèrent non loin de la zone de portée de nos lances improvisées, ils hésitèrent et stoppèrent leur avancée. Aucun d’entre eux ne voulait occuper la première ligne et faire office de soldat sacrifié. La tension était à son comble. Le moindre élément extérieur aurait pu faire voler en éclats ce statut quo provisoire. S’ils s’étaient lancés sur nous à ce moment là je ne pourrais pas raconter cette histoire, mais leur hésitation devait nous sauver. Ils ne s’étaient certainement pas attendus à autre chose qu’à un boulot facile de plus lorsqu’ils avaient pénétré dans notre usine, comme tabasser des manifestants ou des mauvais payeurs, mais notre réaction avait changé la donne. La résistance sonnait son tocsin, et je n’emploie pas totalement une métaphore. Tandis que nous les tenions en respect avec nos armes improvisées nous entendîmes des dizaines de klaxons dans la rue et le vrombissement de plusieurs moteurs. Des portières claquèrent et des voix familières retentirent dans l’usine. Je distinguai celle de Mieres qui criait « vous êtes où ? ». Nous émîmes des mots incompréhensibles, déformés par l’émotion que ce débarquement de forces alliées provoquait en nous, mais ils portèrent tout de même leur effet. Les gars montèrent les escaliers, mais ils n’étaient pas si nombreux que je l’espérais. Une dizaine tout au plus, et tous désarmés. Aurions-nous mal interprété les bruits extérieurs ? De toute évidence nos camarades ne s’attendaient pas du tout à faire face à une telle situation. Deux des nôtres tombèrent sous les coups de matraque de la patota, qui, se sentant encerclée, réagissait d’autant plus violemment. Voyant nos camarades tomber nous nous élançâmes contre nos ennemis en hurlant. Ils reculèrent vers un coin de la salle, nous laissant ainsi l’accès libre à l’escalier et à nos camarades. Deux d’entre eux laissèrent tomber leur matraque. Nous nous arrêtâmes aussitôt à la vue des armes à feu qu’ils braquèrent vers nous. Un cri retentit : « Ne tirez pas ! ». Je ne connaissais pas cette voix. Un homme quelque peu enveloppé, costaud, coiffé de cheveux blanchis trop tôt pour l’âge qu’il apparentait fit irruption dans la salle. Aussitôt des bruits de pas se firent entendre à nouveau en provenance des escaliers, et cette fois, entre les visages connus et ceux que je ne connais- sais pas encore, nous formions un véritable bataillon. Les nouveaux arrivants avaient l’air d’être des travailleurs, comme nous, les visages taillés par l’effort, ridés prématurément suite à une vie passée à l’usine. Mais leur regard semblait plus déterminé que ceux que j’avais l’habitude de croiser. L’homme qui venait de parler reprit la parole. Je sus plus tard qu’il s’agissait d’Eduardo Murua, le président du MNER, et que nos sauveurs n’étaient autres que les légendaires ouvriers d’IMPA.
« On est armés aussi, annonça calmement Murua – il bluffait. Si tu tires, dit-il en s’adressant au plus proche des hommes en noir, aucun d’entre vous ne sort vivant d’ici. On n’a rien à perdre. Puis, se retournant vers les gars d’IMPA, il ajouta : Laissez-les passer les gars ! L’escalier se libéra aussitôt. Maintenant barrez-vous, reprit-il calmement, presque sur un ton las. »
A ce moment là la carburation d’un puissant moteur diesel retentit dans toute l’usine, puis le bruit s’éloigna. Sentant le vent tourner notre ancien patron prenait la fuite à bord du camion dans lequel il était arrivé. Les hommes de main échangèrent un bref regard avec celui qui était manifestement leur chef et suite à une geste imperceptible d’approbation de ce dernier la petite troupe de tortionnaires se retira en courant. Nous scrutâmes leur départ du haut de l’escalier, et vîmes qu’ils emportaient avec eux leurs camarades que nous avions mis hors de combat au rez-de-chaussée. Lorsque nous entendîmes leur camion démarrer puis s’éloigner dans la nuit, nous poussâmes des hurlements de victoire qui je pense firent vibrer les vitres crasseuses de l’usine.
Nos cris de joie laissèrent place peu à peu à une chanson que l’on peut entendre encore aujourd’hui à chaque récupération d’usine :
« Es-ta fabrica
es de los trabajadores,
y al que no le gusta,
se jode,
se jode ! »(7)
Le reste de nos camarades, qui habitaient dans les zones les plus reculées de la province de Buenos Aires arrivèrent dans l’heure qui suivit. Ils entonnèrent à leur tour la chanson ; ils poseraient leurs questions plus tard. Quelques minutes plus tard El Maestro me serra dans ses bras, les yeux pleins de larmes. Il était manifestement arrivé parmi les derniers, si discrètement que je ne l’eus aperçu que quand il se trouvait à un mètre de moi, les bras grands ouverts. Du reste, il ne dit mot jusqu’au lendemain.
Lorsqu’arriva l’aube, nous étions tous là, près d’une centaine de travailleurs, épuisés mais cette fois-ci remplis d’espoir. Nous avions eu le temps de nous rassasier avec les victuailles qu’avaient prévu les gars d’IMPA pour passer la nuit et fraterniser avec ces résistants trempés en acier. Nous mîmes en place au cours de cette assemblée générale improvisée quelques règles simples : ne jamais laisser l’usine sans surveillance, maintenir les accès fermés la nuit et instaurer une rotation régulière. Nos camarades de lutte nous quittaient avec les premiers rayons de soleil, c’était lundi, les machines d’IMPA attendaient leurs maîtres, et nous décidâmes de nous réunir en assemblée le soir même.
J’en profitai pour rentrer chez moi. Mon épouse e vit arriver dans le piteux état dans lequel je me trouvais et me prit dans ses bras. Elle n’eût pas à me demander ce qui était arrivé car je lui racontai tout d’emblée. Sa réaction me surprit puis m’emplit de joie. Je ne savais pas que j’étais marié à une révolutionnaire. Elle voulait participer à la lutte elle aussi, apporter son soutien. Elle se mit à parler de militance, de projets, d’avenir, d’espoir. Elle le retrouvait cet espoir, qui lui avait été arraché des mains avec son récent licenciement, et elle le canalisait dans notre lutte. Aussi je lui proposai de venir à notre assemblée le soir même tandis que mon beau père, ce vieil homme qui m’avait confié la « prunelle de ses yeux » comme il aimait répéter garderait notre fille.
Lorsque j’arrivai le soir même à notre usine avec Rocio je ne m’attendais pas à trouver le rez-de-chaussée noir de monde. Mes camarades étaient tous sur les lieux, bien évidemment, ainsi que certaines de leurs compagnes. Mais certains voisins du quartier, chaussés de sandales, thermos et maté en main, n’ayant pas tardé à apprendre ce qui avait eu lieu la veille, avaient tenu à être présents pour apporter leur soutien à notre cause. Des enfants couraient et se faufilaient pari les adultes tout en poussant de petits gloussements de joie. Je pensai aussitôt au danger qu’ils couraient au regard des événements de la veille mais de toute évidence la majorité ne partageait pas mes craintes. Murua et el Maestro discutaient calmement au fond de la salle. Lorsque mes camarades m’aperçurent, ils poussèrent des cris de surprise et d’excitation, et se mirent aussitôt scander Ventuuura Ventuuura Ventuuura . Apparemment Pedrito et el Mudo Locce avaient quelque peu exagéré dans leur récit ma participation dans l’histoire : tout compte fait je n’avais pas fait grande chose de plus que de me prendre un coup de poing en pleine figure. Rocio se mit à rire. Suite à quelques minutes de bavardages, des voix s’élevèrent pour demander de faire silence.
L’assemblée allait commencer.
Pedrito monta sur une chaise au milieu de la salle et sa quasi chute provoqua un fou rire général. Quand celui-ci se ta- rit, notre jeune camarade demanda au Maestro de prendre la parole. Juan Carlos Larreta ne s’attendait pas à cela, mais il avait le discours lucide. Je me suis toujours dit que s’il avait été moins honnête il aurait pu se lancer dans une carrière politique. La combinaison de sa voix portante et de la précision de ses mots captiva en quelques secondes l’assemblée. El Vasco Murua, qui était lui aussi un orateur expérimenté, regardait la scène avec un sourire approbateur. Après avoir remercié les présents, Juan Carlos Larreta commença : « Ce qui s’est produit hier ici est très grave. Plusieurs de nos camarades auraient pu payer leur audace de leur vie. Mais ce soir ils sont parmi nous – il fut interrompu par des cris de victoire. Mais ce soir ils sont parmi nous, reprit-il avec un sourire et marquant une pause. Mais ceci, muchachos, ce n’est que le début, et le camarade Murua ici présent pourra vous le dire mieux que moi. Maintenant il va falloir résister à des pouvoirs d’un autre ordre, ce qui me force à dire que le plus dur est à venir. Il faut jouer notre carte politique le plus vite possible pour faire basculer la balance en notre faveur. Il faut que Buenos Aires sache ce qui se passe dans ses usines, que le peuple soit avec nous, et c’est pour cela que je demande aux voisins du quartier, au MNER, à nos com- pagnes – il marqua une nouvelle pause – ne nous laissez pas tomber. Ce groupe a besoin de vous tout autant que chacun d’entre nous a besoin de ses camarades. Main- tenant les choses sérieuses commencent, il va falloir résister aux tentatives d’évacuation des flics, aux menaces, aux pressions judiciaires. Il va aussi falloir se remettre à produire, et vite, refaire le carnet de commandes, négocier avec de nouveaux fournisseurs, expliqua Juan Carlos. Son ton se fit plus véhément. Mais camarades continua-t-il en s’exclamant, vous n’êtes pas les premiers à le faire et vous ne serez pas les derniers. »
Je pouvais m’attendre à peu près à toutes les réactions de la part des présents suite à ce discours, mais pas à celle qui suivit. Rocio, cette magnifique jeune femme qui m’avait accepté comme époux se redressa, et plaçant ses mains aux côtés de sa bouche se mit à scander une vieille chanson populaire de cette voix mélodieuse qui m’avait fasciné dès la première fois que je l’avais entendue. Peu à peu les autres l’imitèrent. D’abord quelques camarades, puis toute l’assemblée finit par être gagnée par cet élan collectif. L’usine vibra alors toute entière au son d’el pueblo, unido, jamas sera vencido.
Sylvain Pablo Rotelli
(1) Grill. (2) Bordel. (3) Terme employé pour désigner le fait de pré- parer le maté comme du thé. (4) Confiture de lait. (5) Petit boulot. (6) Meute. (7) Cette usine, c’est celle des travailleurs, et celui qui n’aime pas ça, on le baise. (8). Le peuple, uni, se sera jamais vaincu.
Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :
ARTICLE SUIVANT :














