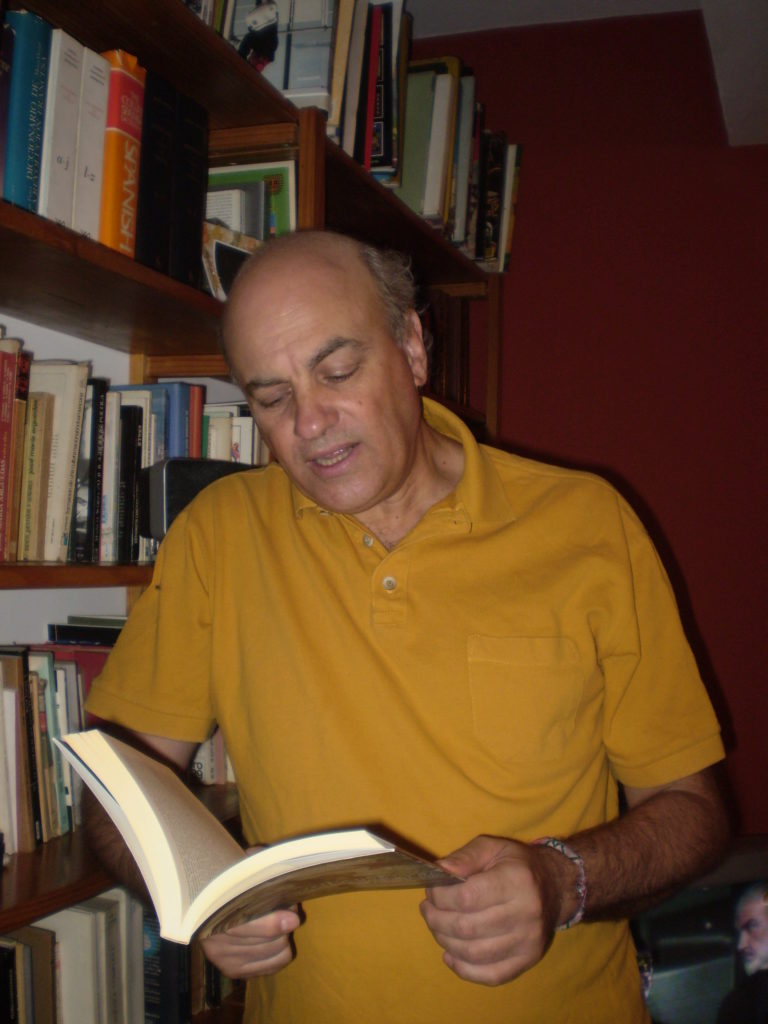« Le Venezuela pourrait se convertir en la Syrie d’Amérique latine »
Le conflit actuel au Venezuela s’explique davantage par des raisons géopolitiques que sociales étant donné qu’il s’agit d’un pays rempli de richesses naturelles et dont la position géographique est stratégique. C’est un pays à la charnière entre deux sous-continents, (l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale) qui sont tous les deux pris dans la tourmente des luttes de pouvoir entre les Etats Unis et la Chine. Après 60 ans de conflit en Colombie, c’est maintenant « une guerre interne qui se fomente au Venezuela, pays qui pourrait alors se transformer en la Syrie de l’Amérique latine », selon le journaliste et le chercheur uruguayen Raúl Zibechi. Contributeur dans des médias comme La Jornada de México ou la Brecha de Uruguay, il parcourt l’Amérique latine depuis trente ans pour y étudier les mouvements sociaux. Entretien.
Propos recueillis par Enrico Llopis pour Resumen Latinoamericano le 1er juillet 2017 et traduit par Jules Panetier pour Le Poing le 7 août 2017.
Dans tes articles et tes livres, tu t’es montré très critique avec les gouvernements progressistes de gauche d’Amérique latine. Maintenant qu’on est face à des attaques de l’extrême-droite vénézuélienne, est elle-même soutenue par les élites mondiales, penses-tu que les mouvements sociaux doivent-ils désormais prendre parti ?
Ils prennent déjà parti et c’est nécessaire qu’ils le fassent car les mouvements sociaux sont la clé de voute des changements possibles et souhaitables. Ce sont les gens du commun organisés qui provoquent ou empêchent des changements. Sans eux, rien de ce qui s’est passé en Amérique latine ces trois ou quatre dernières décennies n’aurait été pareil. L’émergence de gouvernements progressistes de gauche à partir des années 1999 est le produit indirect de ces mouvements sociaux de base. Indirect seulement parce que ces mouvements sociaux n’avaient pas cet objectif spécifique de porter telle personne ou tel parti au gouvernement, même s’ils en ont appuyé un certain nombre, et ceux avant même qu’ils soient au gouvernement.
Le fait est qu’il n’y a pas d’unanimité au sein des mouvements sociaux pour soutenir les gouvernements progressifs de gauche, et qu’il ne peut pas y en avoir. Il y a des mouvements qui appuient le progressisme, d’autres qui s’y opposent, et certains qui ont des positions intermédiaires qui varient selon les conjonctures. Ce qui n’est pas correct, c’est de renier la légitimité de mouvements juste parce qu’ils changent de positions. L’important, c’est d’expliquer pourquoi certains mouvements ont changé de position plutôt que de les taxer d’agents de l’impérialisme. Ça rappelle la période stalinienne quand tout opposant était taxé d’agent de l’impérialisme…
Tu crois qu’il existe une troisième voie ?
Je n’aime pas l’expression « troisième voie », même si je comprends que ça fait référence à une voie qui serait propre aux mouvements sociaux et qui ne passe pas forcément par une stratégie liée à l’État ou aux partis politiques. Je pense que c’est la bonne voie à explorer. C’est une voie qui fait notamment référence à ce qu’on a pu appeler l’autonomie ces dernières années. Cette voie passe par la définition d’une stratégie propre qui, à certains moments, peut établir des liens avec l’État ou avec certains partis, mais qui ne se subordonne à personne.
Cependant, une telle stratégie n’est pas simple parce qu’elle suppose la constitution d’individus collectifs solides, bien implantés dans le paysage politique et, surtout, qui sont capables de créer et de maintenir leur propre culture politique. C’est une voie exceptionnelle qu’on voit peu dans le monde et en Amérique latine, même si on pourrait parler du zapatisme [expérience de transformation sociale et radicale dans les territoires du Chiapas, au Mexique] et des sans-terre brésiliens [organisation brésilienne qui milite pour les paysans sans-terre et dont plus de 1700 militants se sont fait assassiner], deux mouvements qui ont empruntés des chemins bien différents. Construire sa propre stratégie ne peut se faire que dans la longue durée, sans se laisser piéger par les conjonctures politiques et électorales qui, la plupart du temps, affaiblissent les capacités des mouvements sociaux.
Dans un récent article publié dans La Jornada, tu affirmais que la lutte de pouvoir entre les États-Unis et la Chine était en train de fracturer l’Amérique latine. Quelle position occupe le Venezuela dans ce schéma ?
Dans cet article, j’avais recours à une analyse de deux économistes latino-américains qui ont la grande qualité de s’appuyer sur une analyse matérielle et concrète des conflits dans la région plutôt que de s’appuyer sur les vieux radotages idéologiques. Le point de départ de leur analyse, c’est qu’il y a une fracture entre l’Amérique du sud, plutôt porté vers la Chine, et l’Amérique centrale et les Caraïbes, plutôt portés vers les États-Unis. Pour en arriver à ces conclusions, ces deux économistes s’appuient sur des données concernant le commerce extérieur et l’endettement, et ils affirment que l’épicentre de la fracture est au Venezuela.
En quoi consiste cette fracture dont tu parles ?
Dans le monde entier, il y a une lutte entre la puissance décadente et la puissance émergente, c’est-à-dire entre les États-Unis et la Chine. La géopolitique explique toujours un certain nombre de problèmes. C’est une science de caractère impériale, antipathique et détestable, mais qui aide à se positionner et à y voir clair si on arrive à se débarrasser des croyances selon lesquelles l’alternative à l’impérialisme américain serait l’impérialisme chinois ou russe. On parle de puissances qui se disputent l’hégémonie et non pas de forces émancipatrices, n’en déplaisent à certains analystes de gauche. Ce sont des forces oppressantes, et non libératrices. Cette lutte entre puissances peut, et peut seulement, ouvrir un espace aux luttes de bases. Ni plus, ni moins.
Comment se concrétise ce raisonnement dans le cas du Venezuela ?
En partant du schéma dont on vient de parler, ce qu’on voit au Venezuela, c’est un pays rempli de richesses naturelles, d’hydrocarbures et de minéraux, et une position géographique qui va de l’Amérique latine jusqu’aux Caraïbes. C’est un pays à la charnière entre deux sous-continents, comme la Colombie. C’est pour ça que ce sont des territoires stratégiques, où les lignes de frictions entre les empires se transforment en failles tectoniques dans lesquelles émergent des conflits.
Ce qui est riche d’enseignements, c’est de constater que la guerre en Colombie vient de se terminer, une guerre vieille de plus de soixante ans, et qu’il s’ouvre maintenant la possibilité d’une guerre au Venezuela. Je pense qu’il se configure une guerre interne plus qu’une invasion, même si des paramilitaires semblent être en train d’opérer depuis la Colombie. Le Venezuela pourrait bien se convertir en la Syrie d’Amérique latine, ce qui entrainerait une déstabilisation profonde et systémique de tout le continent. Ce serait un véritable orage pour reprendre le langage zapatiste.
Après avoir rappelé son soutien critique à la Révolution bolivarienne, le sociologue Boaventura de Sousa Santos affirme que les conquêtes sociales des vingt dernières années sont indiscutables. Qu’est-ce que tu lui répondrais ?
Il faudrait d’abord préciser ce qu’on entend par conquête sociale. On ne peut pas contester qu’il y a eu une réduction de la pauvreté et une augmentation de la consommation. Cependant, je n’appellerais pas cela des conquêtes sociales parce qu’il ne s’agit pas de changements structurels, comme la réforme agraire ou urbaine, mais il s’agit plutôt d’améliorations d’indicateurs ponctuels et conjoncturels.
Dans les pays avec des gouvernements progressistes de gauche, il y a eu des politiques sociales inspirées des politiques de la Banque mondiale mais plus extensives, ce qui a permis de soulager les secteurs les plus pauvres et de les inclure dans la consommation. Certains pays ont semblé avancer face aux inégalités, mais ce n’est même pas vrai partout, comme l’ont montré des études sur le Brésil et l’Uruguay, qui se sont intéressés aux revenus des 1% les plus riches pendant les gouvernements du PT [Parti des travailleurs, qui a porté Lula et Roussef à la présidence du Brésil] et le Frente Amplio [qui a porté Pepe Mujica à la présidence de l’Uruguay]. Dans ces pays, l’inégalité n’a cessé de croitre.
Donc il n’y pas eu de changements selon toi… ?
Ce qu’il n’y a pas eu, ce sont des changements structurels. Si on parle des vendeurs ambulants et ceux des marchés, et des ramasseurs informels de poubelle, c’est-à-dire de ces majorités pauvres qui composent 60% de notre continent, ils ont aujourd’hui certes plus de revenus, mais ils occupent toujours les mêmes places dans la structure sociale, culturelle et productive. Ceci a un rapport avec l’hégémonie de l’accumulation par vol, qui s’est aggravé dans la dernière décennie, avec la désindustrialisation ou l’empêchement de l’industrialisation.
Dans chaque pays, ça se manifeste de manières différentes. Au Brésil, il y a eu une avancée du commerce agroalimentaire et un recul de l’industrie. Au Venezuela, la situation de rente pétrolière s’est renforcé. Le plus grave, c’est qu’il s’est diffusé une idéologie qui fait croire qu’un monde souhaitable se baserait sur le partage et non sur le travail. Cette idéologie ouvre les portes de la corruption, qui est inhérente à l’accumulation par vol.
Je pense qu’on est dans une période de transition très semblable à celle que nous vivions durant nos indépendances dans la première moitié du XIXe siècle. C’était une période de lutte à mort entre une classe dominante péninsulaire (les dénommés espingouins) et une classe émergente de créoles. Une classe décadente donc, et une autre ascendante qui avait besoin du pouvoir étatique pour consolider sa richesse, ce qui a provoqué une violente appropriation de la terre. Ces deux classes, en particulier celle des créoles, ont fait appel au peuple (indiens, noirs, métis et blancs pauvres) pour renverser la balance en leur faveur, et une fois qu’ils y sont parvenus, ils leur ont tourné le dos. L’oppression sous les républiques fut encore plus violente que sous les monarchies.
Qu’est-ce que tu penses de la défaite électorale de Cristina Kirchner en Argentine et de la chute de Dilma Roussef au Brésil. Tu penses que c’est une régression ou l’ouverture d’une période de nouvelles opportunités ?
Je pense que ce sont des manifestations de ce qu’on appelle la fin d’un cycle. Quelque chose se termine qui va au-delà du changement entre des partis politiques. Ce qui arrive à sa fin, c’est un type de gouvernance basé sur les prix élevés des exportations et une paix sociale lubrifiée par de bons salaires et de bonnes prestations sociales, qui ont précisément pu être versés grâce à ces hauts prix du pétrole, du gaz, des minéraux et du soja.
La fin de ce cycle suppose le triomphe des partis de droite sur un court terme, mais surtout l’ouverture d’une période ingouvernable pendant laquelle personne, pas même les progressistes, auront la possibilité de gouverner dans le calme. Les classes moyennes sont devenues très conservatrices et ont appris à se battre dans la rue. Les secteurs populaires se sont réveillés de la sieste progressiste et sont disponibles pour reprendre les rues et défendre ce qu’ils considèrent comme leurs droits. Pendant ce temps, l’économie suit sa chute libre dans un climat de confusion politique.
Quel scénario à l’horizon au-delà d’une analyse à court terme ?
Si on lève le regard à moyen terme, on peut voir qu’il s’ouvre une nouvelle période pour les mouvements sociaux, avec la possibilité de se dérober de la tutelle pesante de l’étiquette de gauche et de celle du progressisme. Cela permet que certains mouvements sociaux fassent le choix de définir leur propre projet politique, même si je crois que la majorité continuera d’être prisonnier de la vieille culture politique qui fait des chefs un enjeu central et de l’accès à l’état la clé de voute de tout changement.
Je ne suis pas très optimste sur notre capacité à voir plus loin que les périodes électorales, même si certains mouvements de femmes et de jeunes, qui sont les plus actifs en ce moment, semblent quand même rejeter cette perspective.
Quels sont les mouvements sociaux qui sont intéressés par les principes de l’assemblée, de l’autonomie et de l’autogestion et qui sont politiquement actifs ?
Les mouvements de type communautaire, bien qu’il n’existe pas de communauté formelle. J’ai une grande confiance dans le zapatisme, mais aussi dans des franges du mouvement mapuche [communautés aborigènes de la zone centre-sud du Chili et de l’Argentine], dans des mouvements locaux urbains de Mexico et dans la région de Lara (au Venezuela), où il y a eu des expériences notables qui ont réuni des dizaines de milliers de personnes.
Je pense que les mouvements indigènes continuent d’être les plus avancés, même si, ces dernières-années, les mouvements noirs du Brésil et de Colombie se sont aussi renforcés. Il faut rappeler que ce sont des pays où les jeunes et les femmes vivent sous une constante persécution policière et étatique.
Qu’est-ce que pourrait apprendre, selon toi, la gauche occidentale du zapatisme ?
L’éthique. Le zapatisme est une immense école d’éthique. C’est une gauche qui s’est détachée d’un agenda conditionné par l’État et les partis politiques, une gauche qui ne se focalise plus sur l’attention des médias, même si ça implique de ne plus donner de nouvelles pendant des mois et de se réduire au silence. C’est ce chemin qui leur ont permis de bâtir leur propre agenda et leur autonomie. On se demandait quel type de militant naitrait du choix de ne pas prendre le pouvoir étatique, c’est-à-dire de ne pas se battre pour des places, des postes et des rémunérations à l’intérieur du système et le résultat de ce choix, c’est une nouvelle génération de jeunes des communautés qui luttent avec de nouvelles armes, comme la musique, la danse, le théâtre et les connaissances scientifiques. La clé de cette nouvelle génération c’est la création, et ça symbolise aussi la création d’un monde nouveau.
Tu as proposé un regard différent sur le narcotrafic, au-delà des histoires sordides et sanglantes. Peux-tu nous parler de ta vision du narcotrafic et de son application au Mexique et au Guatemala…
J’ai essayé de comprendre quelle fonction occupe le narcotrafic. Si le narcotrafic est une réussite, si ça avance de manière exponentielle dans nos sociétés, ça ne peut pas être seulement parce que c’est une réussite économique. C’est évident que ça remplit aussi des fonctions sociales et culturelles. La question, c’est : qu’est-ce qui se passerait avec les jeunes des secteurs populaires s’il le narcotrafic n’existait pas. Qui sont les principaux bénéficiaires et les principales victimes du narcotrafic ?
En observant des réalités locales dans des quartiers de notre continent, je crois que le narcotrafic sert aujourd’hui de contrôle social dans la zone de non-être, pour utiliser des concepts qui nous viennent de Fanon [psychiatre et essayiste français fortement impliqué dans la lutte pour l’indépendance de l’Algérie]. On rappelle que Deleuze [philosophe français] considérait que les sociétés disciplinaires laissaient ensuite la place à des société de contrôle, c’est-à-dire qu’on passe d’un enfermement volontaire au contrôle à ciel ouvert. Dans son analyse, le principal mode de contrôle est l’endettement, c’est-à-dire quelque chose qui fonctionne dans les zones d’être (où l’humanité de l’être est respecté) tandis que dans les zones de non-être (où la domination s’exerce par la violence) il n’y a pas de capacité d’endettement. Ici le massacre, les paramilitaires, la drogue et les féminicides apparaissent comme des modes de contrôle pour des secteurs ingérables.
On peut se demander ce qui se passerait avec les jeunes s’il n’existait pas ces modes de contrôle, de répression et de génocide. Sans doute qu’ils se révolteraient contre un système qui les condamne à la marginalité et qui leur ferme tout futur. Ils seraient dans la même situation de ceux des générations des années 60 et 70 qui se battaient au risque de perdre leur vie pour mettre fin au système capitaliste.
Je crois surtout que nous devons étudier et travailler sérieusement sur ce thème du narcotrafic.
En mai 2017, Lenín Moreno a succédé à Rafael Correa à la présidence de l’Équateur, après une décennie de ce dernier au pouvoir. Que peut produire un tel virage ?
Moreno a pris ses distances avec Correa et ce qui se profile à l’horizon, c’est une crise qui va pleinement affecter le gouvernement et le principal parti politique : Alianza Pais. Moreno a un style bien différent de Correa, non seulement du point de vue de l’homme et du caractère, mais aussi car il cherche la conciliation entre les différents mouvements sociaux plutôt que leur affrontement. C’est pour ça qu’il a donné à la CONUIE [confédération des nationalités indigènes de l’Équateur] la place qui lui correspondait. Il a aussi tendance à concilier les patrons et la droite, de telle sorte que son gouvernement, bien qu’il soit plus tolérant, est aussi plus centriste dans ce contexte de crise économique aigüe et de déficit hérité par le gouvernement précédent.
Dans des pays comme l’Argentine, il a beaucoup été discuté de la figure du journaliste militant et sur le fait de savoir si c’était cohérent avec les principes de rigueur, de recherche de la vérité et de confrontation de sources différentes. Qu’est-ce que tu penses de ce débat ?
Je me sens autant militant quand je suis journaliste que chercheur. Un diplôme ne donne pas une supériorité morale ou intellectuelle. L’important, c’est l’exigence d’éthique, de rigueur et d’engagement.
La rigueur, c’est de dire la vérité à tout moment, même si c’est gênant. Ce qui ne veut pas dire qu’on ne se trompe pas. On se trompe tout le temps et il faut savoir le reconnaitre.
Quant à l’engagement, depuis que j’ai vécu au Pérou dans les années 1980 pendant la guerre du Sentier lumineux [conflit armé des années 1980 et 1990 au Pérou, qui a fait au moins 70 000 victimes], je me souviens toujours de cette phrase d’Emil Cioran [philosophe et écrivain roumain] qui me guide : « On doit se mettre du coté des opprimés en toutes circonstances, même quand ils se trompent, mais sans perdre de vue qu’ils sont faits du même argile que leurs oppresseurs ».
C’est difficile d’admettre que nous sommes tous pétri du même argile, mais c’est important de s’en rappeler pour s’ouvrir à un sentiment de compassion et limiter l’intransigeance du révolutionnaire qui, très souvent, croit que ceux qui sont disposés à donner leur vie pour une cause sont des être spéciaux, comme le pensait Staline.
La coordination Cri de lutte contre la précarité et les Initiatives sociales Zambra ont publié des livres de Zibechi, comme Le battement de la résistance. Monde nouveau et guerres de dépossessions, 2016 (« Latiendo resistencia. Mundo nuevo y guerras de despojo »), Décoloniser la rébellion, 2014 (« Descolonizar la rebeldia ») et Puissance brésilienne : entre intégration régionale et nouvel impérialisme, 2013 (« Brasil potencia : entre la integracion regional y un nuevo impreialismo).
Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :
ARTICLE SUIVANT :