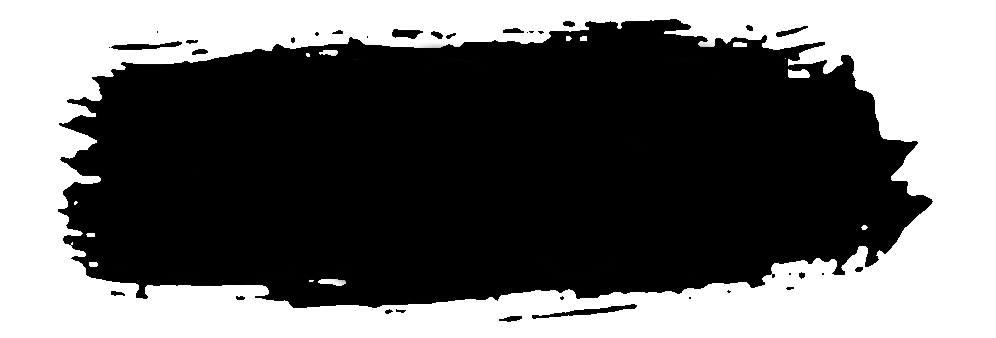Prison : « Le vrai problème, c’est la surincarcération et non la surpopulation »
Le 23 février dernier, le premier ministre a présenté son « plan de lutte contre la radicalisation dans les centres pénitentiaires » qui inclut la création de 1500 places dans des quartiers « étanches » en prison. Selon toi, qui as connu les QHS (quartiers de haute sécurité) et l’isolement, à quoi ressembleront ces quartiers « étanches » ?
Je pense que ces quartiers seront similaires aux quartiers d’isolement, sauf que les autorités ont annoncé que les détenus y seront systématiquement menottés pendant leurs déplacements, c’est-à-dire que des trappes seront installées dans les portes de cellules pour pouvoir menotter le détenu avant d’ouvrir la porte. Cette méthode a déjà été employée contre certains détenus réputés retentissants, mais ce n’était alors qu’une mesure exceptionnelle alors que désormais, cela va être la norme.
Comment as-tu vécu la transition des QHS aux quartiers d’isolement dans les années 1980 ?
Les QHS – qui étaient en fait des QSR (quartiers de sécurité renforcé) ou des QPGS (quartiers de plus grande sécurité) – étaient gouvernés par la force brute et l’autorité absolue des matons. Ils ont officiellement été supprimés en 1982, après l’accession au pouvoir de François Mitterrand, et remplacés par des quartiers d’isolement mais dans les faits, rien n’a changé. La cellule était la même, sauf le tabouret qui a été vissé au sol. La gauche a légitimé l’existence de ces quartiers et a accompagné le passage d’une violence physique à une contrainte technique, à base de menottes, de gazeuses et de piqûres. La gauche veut une violence soft qui n’éclabousse pas les murs. Certaines règles ont été instaurées : en théorie, l’administration pénitentiaire peut placer un détenu pendant 3 mois renouvelables trois fois durant la première année de détention, 4 mois renouvelables deux fois durant la deuxième année, mais en réalité, tu peux rester des années à l’isolement, puisqu’il suffit que l’administration te transfère de prison pour que la procédure recommence depuis le début. Les jeux de lois n’ont rien changé à la situation réelle de l’isolement : le prisonnier n’a de contact qu’avec les matons, qui font sans cesse ressentir au détenu qu’il n’est qu’une merde inutile, inexistante. Les organisations des droits l’homme ont répété sur tous les tons que ce régime d’isolement détruit les individus et pourtant, quand on parle de l’isolement, on n’évoque presque jamais cet aspect de la torture blanche.
Nadia, l’auteure du livre À ceux qui se croient libres, parle d’un phénomène de judiciarisation de la détention. Comment as-tu perçu ce phénomène ?
Dans les années 1970 et 1980, si tu te prenais sérieusement la tête avec un maton, tu te faisais défoncer et tu allais au mitard. Maintenant, tu te fais défoncer, tu vas au mitard et en plus, tu es condamné par le tribunal, donc on rallonge ta peine et tu dois payer des dommages et intérêts. À la moindre insulte, les matons portent plainte et réclament de l’argent au détenu. Pour eux, c’est une manière de se faire un treizième mois. La judiciarisation de la détention permet de rentrer dans les clous du droit européen et de faire croire que le détenu a des droits comme chaque citoyen, mais c’est faux. Dans le code de procédure pénale, c’est d’ailleurs marqué que le détenu « a la possibilité » d’alerter telle ou telle institution mais ce n’est presque jamais marqué qu’il « a le droit de ». Quand on traite des prisonniers d’une manière individuelle et non collective, il n’y a plus aucun droit envisageable.
Comment a évolué le système des remises de peine ?
Dans les années 1970, ce sont les matons qui ont insisté pour que les remises de peines soient mises en place, car c’était une manière de pouvoir contrôler les détenus. Dans les années 1980/1990, les remises de peines ont été remplacées par les grâces présidentielles et le nombre de petites peines a augmenté puisque c’était une période où le chômage a explosé et que l’État avait besoin de gérer cette pauvreté. Ensuite, avec l’arrivée au pouvoir de Sarkozy, les remises de peines ont diminué, la longueur des peines a augmenté, et les délits passibles de prison se sont multipliés. Il n’y a donc pas un problème de surpopulation carcérale, mais un problème de surincarcération.
Comment le profil-type du maton a-t-il évolué depuis les années 1970/1980 ?
Avant les années 1980, il n’y avait quasiment pas de chômage, donc les matons qui étaient là avaient choisi ce métier et il y avait une certaine cohésion entre la base et la direction. Mais à partir des années 1980, le chômage a explosé et il y a eu une nouvelle génération de matons, plus diplômé, plus cultivé, qui ont commencé à avoir des revendications salariales et sociétales, dans le sens où ils voulaient bénéficier d’une certaine reconnaissance sociale, notamment en leur accordant le droit d’être de plus en plus autoritaire à l’encontre des détenus. Des conflits ont émergé entre les matons et les directeurs, alors l’État a changé leurs uniformes, les a fait défiler au 14 juillet et fait en sorte d’être plus sévères envers les détenus. Mais quand les matons en demandent trop, l’État distribue les sanctions et tout rentre dans l’ordre puisque les matons ne sont pas des rebelles. Ils sont plutôt à droite de la droite, pour la peine de mort et sont conscients que la prison ne sert pas à réinsérer des gens, mais à les réprimer.
Comment les luttes des prisonniers ont-elles évolué ?
Dans les années 1970 beaucoup de détenus étaient politisés. À l’époque, le ministère disait qu’il y avait 500 rebelles, qui en entrainaient 5000 qui foutaient le bordel pour 50 000 détenus. Beaucoup de détenus politisés avaient comme principe : « tant que vous nous gardez, on va vous pourrir vos prisons ». Il y a eu beaucoup de répression, et ça s’est progressivement calmé. Les dealers sont arrivés, et eux sont dans une logique comptable, et non politique. L’installation des télés a accéléré ce chacun pour soi, comme la mise en place des douches à l’intérieur des cellules. L’enfermement est de plus en plus individuel, on différencie de plus en plus les régimes de détention et on fait croire aux prisonniers qu’ils peuvent s’en sortir seuls face au JAP (juge d’application des peines) et au SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation). Face au déclin des luttes collectives et au désintéressement général de la société pour la question carcérale, les plus rebelles sont contraints d’agir d’une manière individuelle et violente. Pour le moment, il ne s’agit presque même plus de revendiquer, mais simplement de dénoncer.
Propos recueillis par Jules Panetier
Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :
ARTICLE SUIVANT :