Uber, l’Etat et la pandémie : avant les vies, des profits à tout prix
Suite à l’annonce du 1er ministre du 14 mars concernant « la fermeture de tous les lieux recevant du public non-indispensables à la vie de la nation », et le discours d’Emmanuel Macron deux jours plus tard annonçant un confinement sans en prononcer le nom, la vie du pays s’est soudainement figée. Les plateformes de livraison comme Uber, Deliveroo ou Stuart font exception à la règle : l’économie doit tourner, coûte que coûte. De nombreux restaurants se rabattent sur la livraison à domicile pour amortir les pertes, suivis par une clientèle confinée en manque de restauration rapide. En première ligne, les coursiers précaires. Voici le témoignage d’un livreur Montpelliérain.
Dimanche 22 mars, 18h00. Les rues défilent, vides. Vides, vides, et encore vides. Le paysage apocalyptique vendu par les chaines télés apparaît en réalité bien déconcertant : l’espace urbain n’appartient plus qu’aux livreurs, aux sans-abris et aux quelques camions d’éboueurs. Une brève mise en garde de l’application sur les consignes à appliquer pour permettre un minimum de sécurité sanitaire : avec un ton mi-désinvolte mi-mielleux qui semble ignorer l’ironie amère que soulèvent ces consignes chez ceux qui les reçoivent, Uber flirte avec l’indécence. Hormis les fameux « gestes barrières » que l’entreprise encourage à respecter, sont déclinés un ensemble d’étapes visant à récupérer et remettre les commandes en adoptant une certaine distance avec son interlocuteur. Se rajoute une promesse de remboursement « d’un montant de 25 euros pour l’achat de produits sanitaires », gel hydro-alcoolique et masques – produits qui sont en rupture de stocks dans toutes les pharmacies, même pour les soignants.
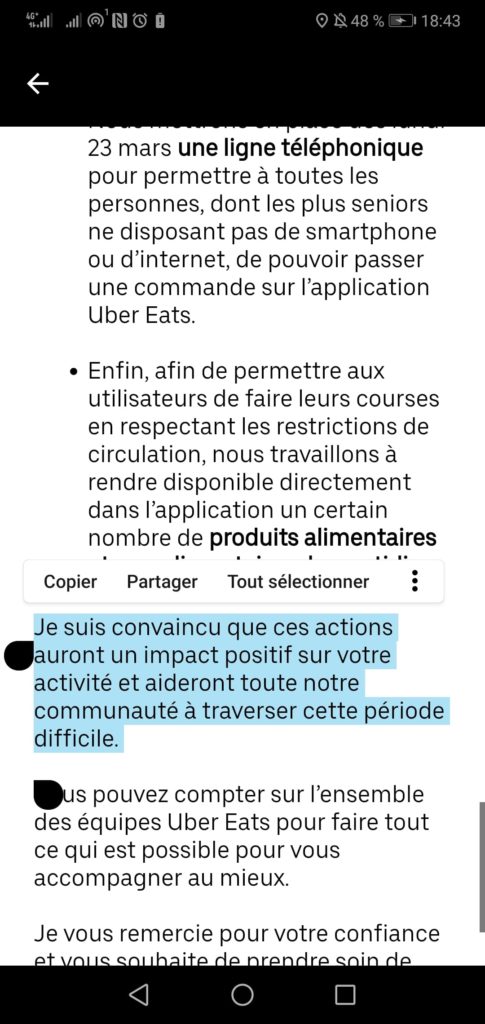
Un respect des consignes à géométrie variable
Dès la première course, la situation a de quoi interloquer : les tables du magasin sont positionnées devant la porte d’entrée pour éviter l’entrée des livreurs. Jusque-là rien d’anormal, il s’agit de faire respecter les distances de sécurité. Au loin, derrière le comptoir au fond du magasin, se trouve un énorme flacon de gel hydro-alcoolique aux côtés du cuisinier. Uber avait annoncé mettre à disposition ce type de produit pour les livreurs dans l’impossibilité de s’en procurer. Ce sera le seul flacon que nous croiserons de la soirée.
Côté client, les consignes sont majoritairement respectées et leur attitude compréhensive face aux difficultés que pose cette situation. Pour plus de sécurité, la commande doit en théorie être déposée devant le domicile de la personne, qui ouvre la porte une fois que le livreur s’est écarté d’au moins un mètre. En théorie. Malgré quelques pourboires et paroles de soutien, la situation apparait totalement décalée en cette période de crise sanitaire : est-ce vital de commander un tacos accompagné d’une portion de frites en de telles conditions ? Cela justifie-il le risque encouru par les employés de restauration et les livreurs et, in fine, les clients eux-mêmes ? La réponse à ces questions parait évidente. Elle ne semble pas vraiment tracasser l’esprit des citadins rencontrés.
En parcourant les routes montpelliéraines, une impression étrange saute aux yeux, au-delà de l’aspect post-apocalyptique du tableau : l’immense décalage entre les annonces de mobilisation policière du gouvernement afin de faire respecter le confinement, et la réalité. Nous rencontrerons une seule patrouille de police durant ce service. Non pas que la surenchère sécuritaire nous semble souhaitable, mais le décalage entre les vidéos de violences policières pullulant sur les réseaux sociaux et une police quasi-absente dans cette situation de crise surprend. Ou peut-être que les forces de l’ordre étaient concentrées sur des quartiers plus périphériques, ces territoires où elles se savent pouvoir agir avec une plus grande impunité que dans les centres villes ?
Les courses s’enchaînent et les restaurants défilent. Force est de constater que les gestes ne sont que rarement respectés dans les établissements, mais aussi par les livreurs. Les distances de sécurité sont inexistantes même si quelques restaurateurs tentent de les faire appliquer avec les moyens du bord. La négligence se fait norme et la situation est en général prise avec humour. Mais le rire devient vite jaune à la vue des coursiers qui s’agglutinent à l’entrée des magasins où la demande est la plus forte. En réalité, il est totalement impossible de suivre un protocole d’hygiène afin d’éviter la contamination dans ce type d’interactions. Surfaces, sacs, aliments, poignées, gants, mains, livreurs, clients, cuisiniers : les surfaces de contact sont nombreuses et variées, rendant impossible toute garantie de sécurité aux travailleurs comme aux clients dans un contexte de pandémie mondialisée. Et se frotter les mains au white spirit toutes les cinq minutes n’y changera rien.
Plus forte que le Covid : la peur du licenciement expéditif
Après plus de deux heures et demie de livraison, petite pause au carrefour de la rue Henri Dunant et de la route de Mende près de la faculté Paul-Valéry. L’artère reliant Montpellier à Castelnau le Lez est habituellement bondée. Mais ce soir, il n’y a plus rien, hormis un désert de vide et de silence. Le paysage qu’offre l’interminable ligne droite est tout bonnement surréaliste. Seul demeure le son du vent et des panneaux publicitaires électriques qui défilent mécaniquement. Puis ces feux de circulations passant du vert au rouge, entre deux clignotements orange, finissant d’esquisser le paradoxe de ce monde déserté, tournant à « vide » tel un décor de théâtre sans acteurs. Un ronronnement de mobylette se fait entendre au loin, laissant apparaître deux pilotes sans casque. Ils traversent l’allée en roue-arrière, puis disparaissent après avoir fait quelques dérapages. Le silence revient, jusqu’à ce que le bruit strident de l’application brise cette accalmie. La « gorafisation » de notre monde n’a jamais semblé si réelle. En route pour une dernière course.
Retour au centre de Montpellier, lui aussi désert. Des camions de la municipalité nettoient le sol d’une place de la Comédie vidée de sa vie : un marbre luisant de propreté, mais pour qui ? Peut-être pour les sans-abris, véritables laissés-pour-compte de la pandémie. Certains déambulent le regard dans le vide, d’autres cherchent désespérément un brin de conversation et de monnaie. Tous sont laissés en perdition, abandonnés par un Etat censé garantir la sécurité de ses citoyens. A la vue de ce tableau saisissant, une conversation s’engage entre quelques livreurs. L’un se réjouit des courses régulières tandis que d’autres s’inquiètent de leur situation, autant sur le plan sanitaire que financier. La menace d’un licenciement sans la moindre raison pèse toujours sur la tête des « salariés cachés » de l’entreprise. Travaillant sous le statut d’auto-entrepreneur, les coursiers ne bénéficient d’aucune couverture ou protection face à leur employeur : une aberration permise grâce au travail d’Emmanuel Macron lorsqu’il officiait dans les gouvernements Hollande. Arrive enfin le sujet du couvre-feu prononcé par arrêté, qui interdit la circulation des personnes à partir de 22 heures. Les restaurants peuvent continuer leur activité mais Uber clôture la plateforme de commande à 21h30. Reste aux coursiers à se débrouiller pour livrer les dernières commandes et rentrer chez eux dans les temps.
A la fin de cette soirée de livraison il est 21h40. Pour environ 3h40 de travail, le paiement de la plateforme s’élève à 35 euros : soit 9.45€ de l’heure brut, dont il reste à déduire 22% de cotisations destinées à l’URSSAF, ainsi que les frais d’essence et d’assurance pour les livreurs travaillant en scooter. Uber n’a prévu ni prime, ni tarification exceptionnelle au regard de la situation, seulement une possible indemnisation d’une durée de 14 jours en cas d’activité interrompue, mais seulement dans un cas bien précis : si on est infecté par le Covid-19.
Malgré la peur, les langues se délient
Quelques jours après cette soirée de livraison, nous recevrons l’appel d’une salariée de Uber qui récolte des comptes-rendus de la situation sur le terrain. Après le récit présenté ci-dessus, l’échange devient intéressant, inattendu même quand on connait la surveillance orwelienne dont font l’objet ces standardistes des temps modernes. La salariée à l’autre bout du fil parait gênée, mal à l’aise. Le « on » impersonnel qui se voulait incarner de manière abstraite l’entreprise cède la place au « je » de l’individu. Elle soulève la difficulté de devoir travailler dans une entreprise dont on ne cautionne ni le fonctionnement, ni les choix, quand celle-ci met délibérément en danger la santé des personnes afin de continuer à faire du profit. On tombe d’accord sur la nécessité urgente de suspendre intégralement ces activités, ou du moins de réquisitionner le secteur des services de livraison afin de délivrer médicaments et courses alimentaires aux personnes vulnérables. Ni regard ni contact, seul un échange vocal, et nous voilà soudainement proches dans notre incompréhension, sidérés face à une société dont nous ne cernons plus la finalité. C’est peut-être même l’inverse, car c’est précisément dans ce moment particulier que nous saisissons collectivement sa seule finalité : le profit. Et tant pis pour les vies.
Mon interlocutrice m’avoue, sans grande surprise d’ailleurs, qu’Uber continuera les livraisons tant que le gouvernement ne le lui interdira pas. Ce qui n’est pas illogique pour une structure de ce type, sorte de quintessence du capitalisme contemporain qui allie l’ultra-modernité technologique à une conception du travail digne du XIXe siècle, la course aux bénéfices permanente et à n’importe quel prix faisant partie de son ADN. Ne reste plus qu’une décision politique pour mettre un coup d’arrêt à cette situation qui deviendra à coup sûr dramatique dans les semaines à venir. Mais, la chose n’est un mystère pour personne depuis le début du confinement : l’irresponsabilité politique dépasse désormais l’incompétence notoire pour atteindre une dimension criminelle. Pas de planification globale de la lutte face à la pandémie, ni de réquisition des secteurs de l’économie qui pourraient contribuer à l’effort national contre le coronavirus. De Muriel Pénicaud à Edouard Philippe en passant par Emmanuel Macron le mot d’ordre reste le même, partout, pour toutes et pour tous : faire tourner l’économie. Produisez des chaussettes et livrez des hamburgers au dépens de vos vies, pourvu que le capital survive.
Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :
ARTICLE SUIVANT :















