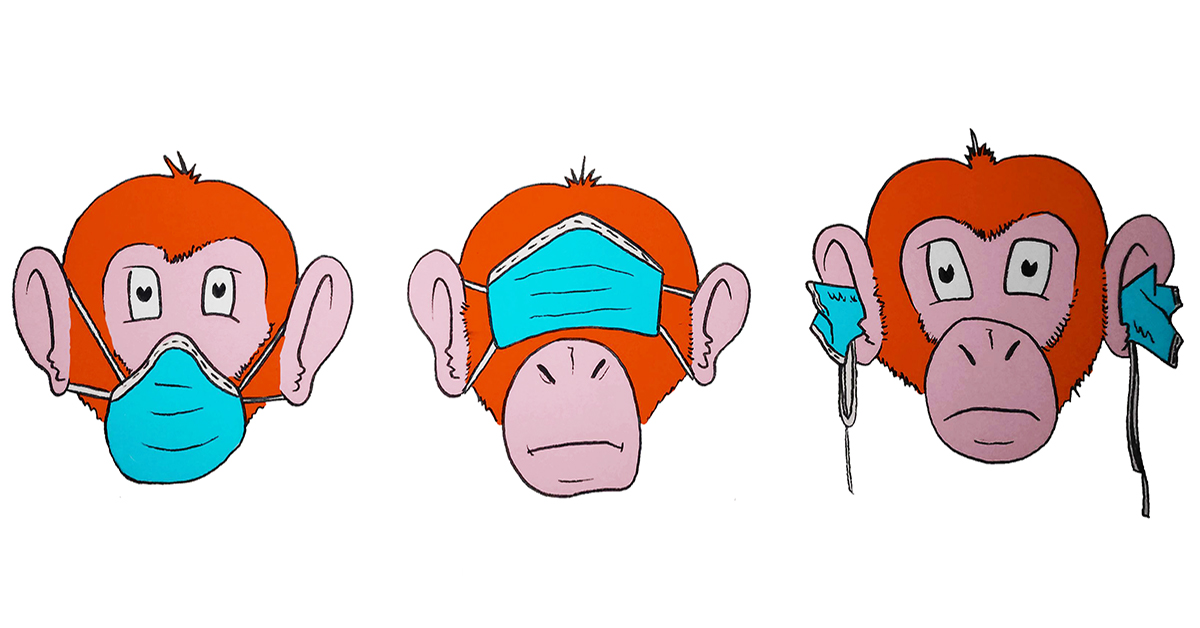Peut-on critiquer tout ? Y compris la médecine ? | Entretien avec le docteur Patrick Fornos
Patrick Fornos est un généraliste montpelliérain, aux références anarchistes.
Des avortements clandestins des années 1970 à l’épidémie de Sida des années 1980-90, de la psychothérapie institutionnelle au refus de s’affilier à l’Ordre des médecins (créé par Pétain) : l’histoire récente de la médecine a connu bien des moments de remises en cause militantes. Des soignants, aussi bien que des patients, n’avaient alors pas peur de soumettre l’institution médicale à de grands assauts critiques.
Contrôle des populations, hiérarchies implacables, infantilisation des patients, imposition non questionnée de normes idéologiquement marquées, entretien d’un savoir-pouvoir opaque, collusion avec les intérêts de l’industrie, ralliement aux classes dominantes, exploitation et sujétion des personnels soignants subalternes… Toujours actuels, ce ne sont pas les angles d’attaque qui manquent !
Dans l’épidémie de Coronavirus, tout cela semble s’être évanoui. A force d’opposer l’hôpital public – le côté du bien – au capitalisme néo-libéral et son monde – le côté du mal – on en vient à sanctifier l’institution médicale en tant que telle. Au-dessus de tout soupçon, les représentants de sa haute caste semblent avoir pris le contrôle de toute la société, notamment sa sphère médiatique ; et de nos esprits.
Il ne nous a pas été simple de dénicher un médecin montpelliérain qui accepte de s’aventurer à nouveau sur ce terrain critique. Diplômé en gériatrie, Patrick Fornos, 60 ans, a d’abord exercé dans le monde hospitalier, avant de revenir à la médecine de ville en cabinet. Notamment par son histoire familiale ancrée dans la révolution et la guerre civile espagnole (1936-39), il se revendique de filiation anarchiste. Il compte parmi les animateurs du Centre Ascaso-Durutti, lieu de culture et d’échanges libertaires à Montpellier.
Comme il en va de tout entretien, bien entendu les propos de Patrick Fornos reproduits ici n’engagent que lui (quitte, parfois, à surprendre) – et non la rédaction du Poing.

Le Poing : Imaginons que nous ne soyons pas en train de vivre la pandémie de Coronavirus. Quels seraient les axes critiques que vous pourriez développer à propos de la médecine, en lien avec vos références anarchistes ?
P.F : Le fonctionnement de la médecine est directement soumis au pouvoir énorme de l’industrie pharmaceutique ; en définitive aux intérêts financiers. Inutile de rappeler tous les liens de collusion entretenus à ce niveau là, avec le lobbying, la confusion des genres entre juge et partie, au sein du monde médical. Il faut souligner que cela a un impact sur l’idéologie de la médecine. On crée des molécules, et pour les rentabiliser, on catégorise des troubles, voire on invente des maladies ; l’accroissement des bénéfices étant l’objectif premier.
Mon deuxième axe très fort dans la critique est le formatage de la pratique médicale, soumise à des logiques mécaniques. Des Objectifs de santé publique sont imposés, selon des normes de gestion. Il en découle une robotisation de la pratique médicale. Il faut mettre les patients dans des cases. Même les généralistes dépendent de ce fonctionnement : en fin d’année, des primes de 7000, 8000 euros, voire plus – ça n’est pas rien ! – leur sont attribuées en fonction de leurs performances (combien de fonds d’œil, de mammographies, de diabètes équilibrés, ont-ils obtenu).
Il en découle une dégradation grave de la dimension humaine du soin, dans laquelle l’empathie, le ressenti, l’intuition jouent un rôle important, qu’on ne pourra jamais rabattre sur des codifications de normes. Je refuse totalement cette idée qu’une évaluation de ma pratique soit indexée sur une conception comptable de mes actes. Sans quoi, une suspicion légitime a toute chance de s’instaurer entre le médecin et le patient : ce dernier a toutes raisons de soupçonner les motivations de son médecin derrière telle ou telle prescription.
N’y a-t-il pas beaucoup à dire aussi sur l’entretien des hiérarchies, la massification des pratiques, la dureté des rapports de pouvoir au sein du monde hospitalier ?
Je n’y suis plus depuis un bon nombre d’années. Il semblerait que des améliorations aient été apportées, dans le sens d’une certaine démocratisation. Disons que j’espère qu’on n’en est plus au régime de pouvoir absolu des mandarins. Toutefois, cette évolution positive probable ne pèse sans doute pas beaucoup en comparaison du saccage survenu avec la soumission des hôpitaux au management néo-libéral. On en parle tellement que je ne vais pas détailler la chose ici.
Mais l’hôpital n’est-il pas aussi, de manière aiguë, une institution où le patient est avalé dans une machine de contrôle et assujettissement, qui lui fait perdre toute autonomie en le soumettant à d’intenses relations de pouvoir ?
Ah, ah, je vois poindre là de beaux restes de Mai 68 ! Mais intéressants. La médecine entretient et développe un savoir, indubitablement. Mais contrairement à une image très installée, il ne s’agit absolument pas d’une science exacte, mais d’une pratique. Le médecin a un savoir, mais il n’est pas un savant, il est un praticien. Quant au patient, il détient lui aussi toute une connaissance : il se connaît lui-même, il sait certaines limites, il a ses propres valeurs pour arbitrer ses prises de risques, il a une appréciation de son existence, de son environnement, des contraintes.
Il y a là beaucoup d’aspects sur lesquels un médecin n’a pas à décider. Il n’y a pas deux personnes identiques. Le malade n’a pas à obéir à un diktat de la science. Faire de la bonne médecine, c’est d’abord comprendre les gens, d’abord les écouter. Asthme, eczéma, mal au dos, troubles du sommeil, etc : 60 % de la pathologie est lié à l’environnemental, aux parcours de vie, aux violences familiales, au stress au travail (ô combien!). Ne pas écouter les patients vous raconter leur vie, c’est passer complètement à côté de leur pathologie.
Nous venons de brosser rapidement un cadre général d’approche critique de la médecine. Comment cela se traduit-il dans votre perception de l’épidémie actuelle ?
Je risque de vous surprendre, voire de vous décevoir, dans certaines de mes conclusions. Je suis convaincu qu’il ne faut pas confondre mécaniquement une problématique critique générale, et un phénomène et contexte particulier. C’est un raccourci dangereux de se contenter de plaquer des convictions générales sur un phénomène spécifique donné. Cela a un nom : c’est l’instrumentalisation. Laissons aux politiciens communs la manipulation grossière de ce genre de ficelles. Certes, l’épidémie révèle et exacerbe nombre de travers de notre société. Je ne vais pas le gommer. Certes, la gestion ultra-libérale imposée à l’hôpital public a des effets très lourds sur le traitement de cette épidémie.
Mais cela posé, ça ne m’intéresse pas de seulement m’en servir pour aboyer contre le gouvernement. L’épidémie reste singulière, exceptionnelle, avec quantité d’aspects difficilement prévisibles. Je ne cherche pas à dédouaner les responsables. En revanche, je m’inquiète de cette société qui imagine qu’on pourrait, et qu’il faudrait tendre vers le risque zéro ; qui voudrait nier la fragilité essentielle de notre condition humaine. Cela va avec l’idée que l’État devrait tout prendre en charge, nous protéger absolument de tout, et que s’il ne le fait pas, c’est insupportable. D’un point de vue anarchiste, je préfère compter le moins possible sur une prise en main de nos vies par l’État.
On pourrait s’inquiéter du pouvoir médiatique qui contribue à exacerber les peurs, fondant par là les logiques sécuritaires de contrôle étatique, particulièrement dangereuses.
Toute perte d’une vie est tragique. Mais à l’échelle globale, comparée à d’autres, il n’est pas si sûr que cette épidémie soit effroyablement dramatique. Ramenée à une période de quelques décennies, ses effets risquent de se repérer assez peu sur les courbes statistiques de mortalité. Regardez les mille marins infectés du Charles-De-Gaulle. Au moment où nous parlons, un seul est en réanimation. Ce qui n’est pas synonyme de décédé.
Compte tenu de toutes les incertitudes, de la méconnaissance générale, il semble raisonnable que le confinement généralisé ait bien été la mesure nécessaire à prendre. Puisqu’on parle d’imprévoyance, imaginons alors que cette mesure ait été appliquée dès le mois de janvier. Quel n’aurait pas été le tollé contre le gouvernement !
Comme vous le dites, le traitement médiatique sensationnaliste pousse à la panique dans un monde déjà adepte de la culture de la peur. Nietzsche doit se retourner dans sa tombe. D’où ces effets de demander au gouvernement d’affirmer encore plus de pouvoir ; évidemment, il ne faut pas trop le pousser pour qu’il le prenne. C’est le genre de limite que j’ai trouvé aux Gilets jaunes : se retourner complètement contre le gouvernement, et non vers les lieux du capitalisme et de l’exploitation qui sont à la base.
Imaginez-vous des politiques alternatives à celles qui sont actuellement conduites ?
Il y a eu bien sûr des choix très critiquables. Les masques. Les tests. Bref, les tests, on n’en a pas. Je veux bien aboyer à ce propos. Mais que faire ? Nous commençons à avoir un certain recul, et à pouvoir définir qui sont les gens qui présentent le plus de risques et méritent le plus de suivi. On n’est pas dans le modèle d’Ebola, qui voyait mourir 90 % des personnes contaminés. Le COVID-19 est beaucoup plus sélectif, avec 90 % des personnes contaminées qui restent sans effets significatifs, et moins de 10 % qui sont secouées, seulement 1% qui décède.
On peut déjà affiner considérablement le tableaux des personnes les plus problématiques : des hommes plutôt que des femmes, à 75% âgés de plus de 75 ans (et 17% de 65 à 75 ans). Et dans ces deux groupes, la même proportion, de 70% de co-morbidités. Lesquelles sont clairement cernées elles aussi : l’obésité en tout premier plan, les insuffisances cardiaques et respiratoires, les cancers évolués, les diabètes déséquilibrés. Sorti de ces paramètres, une personne contaminée a nettement moins de risque de mourir du Coronavirus que d’un accident de la circulation dans l’année qui vient.
Autrement dit, nous disposons de données assez fiables pour devenir toujours plus efficaces ; et songer aussi à nous prémunir des effets collatéraux catastrophiques, en termes de misère sociale, de pertes d’emplois, de décompensations physiques et psychiques, qui se traduisent aussi en termes de mortalité ; à prendre en compte. Je fais partie de ceux qui luttent contre cette société marchande et technocratique. Mais je ne peux pas me satisfaire de seulement sur-accuser le pouvoir du moment d’avoir favorisé une épidémie, causée par un virus dont, franchement, on ne savait à peu près rien voici quelques semaines.
J’aurais du mal à me reconnaître dans ces médecins libéraux, qui hurlent toute l’année contre les effets intrusifs d’un État qui, soit-disant, les empêcherait d’exercer comme ils l’entendent (pour bonne part, entendons : faire autant de profit qu’ils le souhaiteraient). Et soudain, les mêmes reprochent à l’État d’avoir été beaucoup trop absent. Mais eux-mêmes, quelles précautions ont-ils adoptées, qu’ont-ils fait pour se préparer concrètement à affronter cette épreuve collective ?
Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :
ARTICLE SUIVANT :