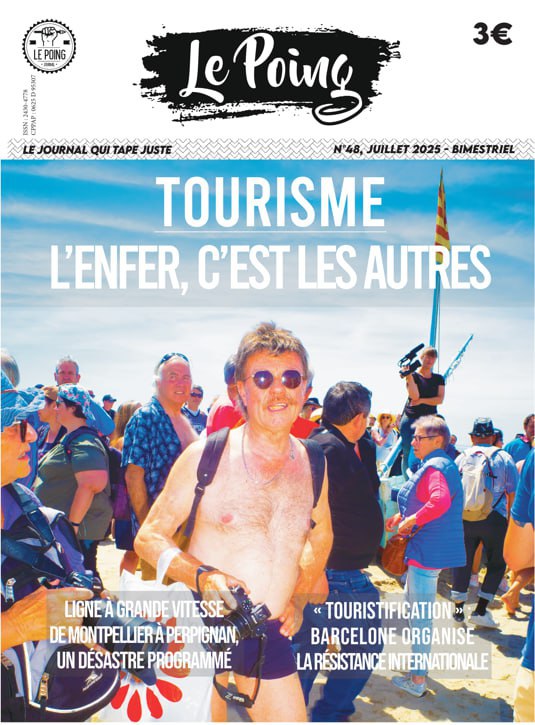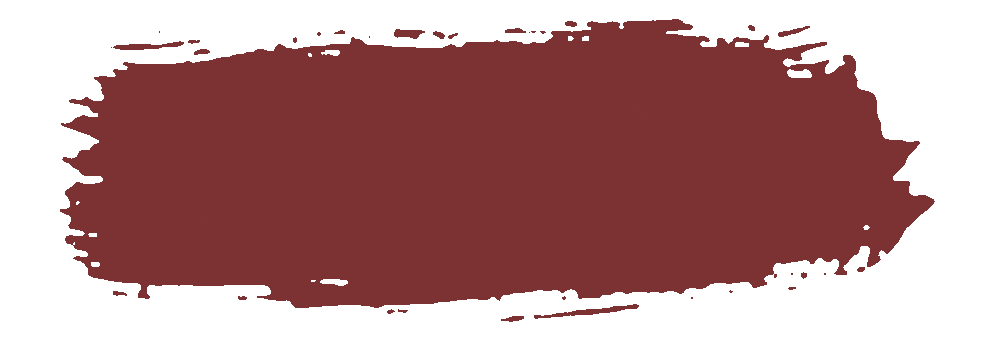Voisins vigilants, milices : un chercheur montpelliérain étudie “l’idéologie de la sécurité”
Dans son récent livre “Vigilantisme et idéologie de la sécurité”, Matthijs Gardenier, maître de conférences en sociologie à l’Université de Montpellier Paul-Valéry, analyse la montée des justiciers autoproclamés, des voisins vigilants aux groupes anti-migrants. Il présentera son ouvrage à la librairie Montpelliéraine la Symbolique du poulet le jeudi 27 novembre à 19 heures. Entretien
Le Poing : Comment définir le vigilantisme ? Qu’est-ce qui le distingue de l’auto-défense ou de la justice communautaire ?
Matthijs Gardenier : C’est un mot plutôt un mot anglo-saxon, qui a été créé aux Etats-Unis à partir de l’espagnol vigilante, qui signifie surveiller. Cela fait référence aux justiciers dans l’ouest américain au XIXe siècle, qui se réunissaient quand il y avait un crime pour faire une sorte de session secrète de justice. Ils punissaient ensuite les coupables soit en les frappant, soit, comme on le voit dans Lucky Luke, en les raccompagnant hors de la ville couverts de goudron et de plumes, ce qui était en réalité mortel.
Par extension, le vigilantisme désigne les gens qui vont faire un travail de police et/ou de justice en lieu et place des institutions étatiques. Les politistes Rosenbaum et Sederberg en distinguent deux types : d’un côté, un vigilantisme qui cible des individus, où un individu est ciblé est puni pour un délit ou un crime, et de l’autre, un vigilantisme plus radical, qui contrôle des groupes sociaux, où des gens se retrouvent pour contrôler une partie de la population jugée problématique, souvent une minorité ethnique ou sexuelle.
La différence avec l’autodéfense, c’est que l’autodéfense est individuelle : par exemple, en France, dans les années 70, une association appelée “Légitime Défense”, marquée très à droite, militait pour le droit d’avoir des armes chez soi et de pouvoir ouvrir le feu en cas de violation de domicile. C’est une réponse individuelle. A contrario, le vigilantisme est un mouvement collectif, structuré et organisé. En ce qui concerne les modes de justice communautaire indépendantes de l’État, comme on peut le voir par exemple chez les indigènes du Mexique, ce sont des formes de vigilantisme. Comme la police fédérale et les agences locales sont souvent aux mains des narcos, ils s’organisent en dehors de l’État : ils ont des cours de police, de justice, avec des peines alternatives à la prison, comme les travaux forcés. D’ailleurs, certaines polices communautaires dérivent en organisations criminelles et ont même pris la place des cartels de drogues après en avoir éliminé les membres. (Le film Cartel Land décrit très bien cette réalité.)
Le Poing : Qu’est-ce qui vous a conduit à travailler sur le vigilantisme et à en faire un objet central de recherche ?
M. G : Je me suis rendu compte il y a quelques années qu’on assistait à un retour de ce phénomène. On a vu des espèces de milices anti-migrants se sont constituer autour de 2015, quand les médias évoquaient la “crise des migrants” avec l’arrivée de plus d’un million de personnes en Europe. Parallèlement, j’ai constaté que les citoyens étaient de plus en plus appelés à surveiller, à collaborer, à faire acte de police en lien avec l’autorité. C’est à mettre en lien avec ce que le philosophe Grégoire Chamayou appelle le libéralisme autoritaire : à contrario du libéralisme classique, le néo-libéralisme a besoin d’une action forte de l’État pour contrôler le marché, et les instances de gouvernance “classiques” comme les élections, y sont perçues comme dangereuses car potentiellement tentées par le populisme.
En conséquence, on observe une mise en place d’une gouvernance transnationale où l’État partage le pouvoir avec des forces du capital, des associations… Le champ de la sécurité est également soumis à cette gouvernance partagée : l’État n’a plus le monopole de la violence légitime, la sécurité va aussi être produite par des entreprises privées, des citoyens, des travailleurs sociaux ou des banquiers qui vont dénoncer des gens… On passe d’un modèle de surveillance verticale, qui venait du haut, par l’État, à un modèle de surveillance latérale, ou tout le monde surveille tout le monde. Cela devient un marché, on appelle ça le capitalisme de surveillance.
Le Poing : Comment avez-vous procédé pour travailler sur cette question ?
M. G. : J’ai réalisé un terrain à Calais entre 2014 et 2018 et un autre de l’autre côté de la Manche, à Douvres, entre 2019 et 2023. Je me suis intéressé aux groupes anti-migrants qui entendaient patrouiller pour surveiller la situation migratoire. Il faut savoir qu’entre Calais et Douvres, beaucoup de demandeurs d’asile passent illégalement, ils restent dans des campements, ce qui crée des interventions policières et des situations humanitaires terribles. Ces groupes anti-migrants prétendent intervenir pour réguler cette situation tout en demandant un durcissement des politiques migratoires.J’ai aussi travaillé sur le phénomène des voisins vigilants. On est pas à proprement parler dans le vigilantisme, car dans le vigilantisme, il y a une notion d’intervention, or, les voisins vigilants n’interviennent pas, ils surveillent et appellent la police en cas de besoin.
Le Poing : Qui sont ces individus ou groupes qui s’autoproclament gardiens de la sécurité ? Peut-on dresser un profil sociologique ?
M. G. : : Du côté des militants anti-migrants de base, en Angleterre, ce n’est pas uniquement des hommes, il y aussi des femmes, ce qui pourrait sembler surprenant. Ce sont des souvent des personnes précaires, qui ont du temps. Mais les chefs de ces groupes sont souvent des bourgeois avec des diplômes de grandes universités, certains sont mêmes financés par des aristocrates conservateurs.
Concernant les voisins vigilants, il y a deux profils principaux : des hommes aisés, retraités, propriétaires, issus de professions supérieures (chefs d’entreprises, cadres, anciens officiers de police…), dans des quartiers ou il n’y a pas ou très peu de délinquance. Il y a aussi des cas, minoritaires, de communautés où l’on retrouve des gens actifs issus des catégories établies des classes populaires (agents de sécurité, infirmiers, brancardiers…) qui vivent dans des quartiers où il y a effectivement de la délinquance.
Dans le cas majoritaire des quartiers où il n’y a pas ou peu délinquance, il y a un paradoxe : ils prétendent s’organiser pour assurer la surveillance du quartier, mais n’interviennent pas et appellent juste la police en cas de problème. Pourquoi s’organiser si c’est juste pour appeler la police en cas de besoin ?
Le Poing : Justement, quelle est leur motivation ?
M. G. : Il y a une question de prévention de la délinquance : on parle ici de peur dérivative, c’est-à-dire une peur de quelque chose qui pourrait arriver. Les gens de ces quartiers vont apostropher les gens qui y passent perçus comme illégitimes, en leur demandant ce qu’ils font là…
J’ai observé que souvent, les référents de ces communautés étaient proches des pouvoirs locaux : adjoints au maire, proches de la mairie… Le fait d’aller dans ces quartiers est d’y connaître tout le monde est une manière d’accumuler du capital politique à l’échelle locale, pour transformer ce capital en une place d’élu ou en obtenant un financement pour une association, par exemple…
J’avais également dressé une hypothèse de lien avec une politisation à l’extrême droite : en effet, ça existe, mais pas plus que dans le reste de la société. Il y a des voisins vigilants centristes, de gauche… Cela montre que la question sécuritaire n’est pas uniquement l’apanage de l’extrême droite, qui capitalise dessus, mais traverse tout le champ politique.
Le Poing : En France, comment le dispositif “Voisins vigilants” a-t-il transformé les rapports de voisinage ? Est-ce que ça crée une forme de lien social par la sécurité ?
M. G. : J’aurai tendance à dire que non, car dans des endroits où il y a déjà du lien social, il n’y a pas besoin de dispositif sécuritaire pour faire attention les uns aux autres, la surveillance découle de la solidarité. Par contre, l’argument mis en avant par les voisins vigilants, c’est de recréer de la solidarité par la surveillance, mais dans les faits, la plupart du temps, c’est uniquement une logique assurantielle, il n’y a pas de solidarité concrète qui nait de ces dispositifs.
Le Poing : Est-ce que ça traduit une défiance envers l’État, un manque de confiance en les institutions publiques, une volonté d’en faire encore plus ?
M. G : On peut dresser une typologie du rapport à l’État des vigilantistes qui se répartit en trois catégories : ceux qui s’organisent “à la place” de l’État car il n’existe pas, ceux qui veulent faire “mieux que l’État”, qui pensent que l’État est laxiste et qu’il faut plus punir certaines choses avec une revendication de durcissement pénal, et ceux qui ne reconnaissent pas l’État et qui veulent mettre en place un ordre supérieur : en France, ils sont représentés par le mouvement conspirationniste des citoyens souverains. En Allemagne, ils sont plusieurs milliers, émettent leurs propres passeports, ont leur propre cour de justice et sont lourdement armés. Ils sont à l’origine de deux tentatives de coups d’État, déjouées.
Le Poing : Et quel est leur rapport à la police ?
M. G. : Concernant les voisins vigilants, des dispositifs comme “participation citoyenne” sont encadrés par la gendarmerie. D’autres sont plus indépendants, comme le site “voisins vigilants point org”.
En ce qui concerne les milices, c’est ambigu. Leur activité est illégale, et voudrait dire d’une certaine manière que la police ne ferait pas correctement son travail, ce qui la desservirait. Néanmoins, on observe que la police tolère l’existence de ces groupes, voire, en période de mouvement social, laisse ces groupes s’en prendre à des manifestants, comme ça a été le cas ces derniers mois en Serbie, ou pendant les émeutes à Hong-Kong, où la police a laissé des groupes armés par les mafias chinoises frapper des jeunes dans la rue. De toute façon, pour que le vigilantisme existe et s’enracine, il faut une forme de tolérance de la part des autorités.
Le Poing : Observe-t-on une continuité ou une fracture entre les “formes soft” (voisins vigilants) et les groupes plus radicaux comme les anti-migrants ?
M.G. : Pour qu’il y ait vigilantisme, il faut qu’il y ait une surveillance localisée puis une intervention et une punition. Les voisins vigilants font uniquement de la surveillance, donc ce n’est pas vraiment du vigilantisme, mais c’est une logique de surveillance généralisée, qui est l’antichambre des milices. D’ailleurs, les voisins vigilants peuvent devenir miliciens : ça s’est vu en Nouvelle-Calédonie pendant le soulèvement de 2024 contre le dégel du corps électoral, ou des voisins vigilants se sont armés et ont barricadé leur quartier, en se mélangeant avec des milices loyalistes (favorables à l’État Français) déjà organisées. Ces gens-là ont tué des émeutiers, et même des policiers.
Le Poing : C’est pour recouper ces différentes formes de mobilisations sécuritaires que vous utilisez le concept“d’idéologie de la sécurité” ?
M. G. : Oui, cela vient des travaux du sociologue Didier Fassin, qui note un changement du rapport des citoyens à la sécurité : précédemment, il y avait une police, une justice, et l’État devait faire appliquer des sanctions qui relevaient du droit, avec une logique de réintégration de l’auteur des faits dans la société. Ce que dit cet auteur, c’est que depuis les années 70, il y a un retour à une sorte de justice pré-moderne. On se préoccupe plus de la victime que d’empêcher la récidive de l’auteur, et qu’il faut punir violemment cette personne. On ne s’intéresse plus à la réintégration de l’auteur de l’infraction dans la société, et la justice est spectacularisée.
Cela s’explique par des changements sociétaux : la peur de la guerre, de la bombe nucléaire, s’est estompée au profit d’autres peurs, provoquées par le néolibéralisme : il n’y a plus de sécurité de l’emploi, de sécurité de logement… Il y a une forme d’insécurité généralisée, et face au “réalisme capitaliste” qui suppose qu’il n’y a pas d’autres alternatives, le discours sécuritaire affirme que la seule marge de manœuvre qui resterait pour se sentir en sécurité quelque part serait d’être violent avec les délinquants, qui ont plus de chance d’être pauvres et racisés. Cela sert des logiques capitalistes.
Le Poing : Pouvez-vous citer des exemples concrets de situations dangereuses liés à la normalisation du vigilantisme pour les minorités, les migrants, les jeunes ou les personnes perçues comme “déviantes” ?
M. G. : En Colombie, il y a ce qu’on appelle les les “limpiezas socials”, des citoyens qui créent des cagnottes pour payer des para-militaires afin de les débarrasser d’individus délinquants et pauvres : ça donne des exécutions extra-judiciaires. En Europe, on a vu récemment le phénomène des émeutes anti-immigration, en Espagne, en Irlande ou en Angleterre. En Angleterre, les émeutes de l’été dernier ont démarré après un affreux crime où des petites filles ont été tuées à Southport: des rumeurs ont circulé comme quoi l’auteur était un demandeur d’asile, alors qu’en réalité c’était un jeune britannique d’origine rwandaise, et la logique de ces émeutes a été de faire payer toute une communauté pour un acte individuel. Des centres d’hébergement de demandeurs d’asile ont ainsi été visés, et des émeutiers se sont organisés pour punir collectivement des réfugiés.
Le Poing : Comment s’articulent les discours politiques dominants – notamment autour de l’insécurité, de l’identité ou des frontières –et ces pratiques ?
M. G. : L’extrême droite s’adapte aux préoccupations du moment. Le régime nazi ne se préoccupait pas de l’immigration et de la sécurité, les problèmes de ses dirigeants étaient les juifs, les francs-maçons et les communistes. La question de l’immigration et le discours sécuritaire arrivent tardivement dans le logiciel de l’extrême droite européenne. Ce sont plutôt des préoccupations sociétales, transversales et pas uniquement portées par l’extrême-droite, qui sont reprises par ce camp pour mobiliser dessus. Par exemple, la question sécuritaire liée à la guerre à la drogue aux États-Unis n’a pas été portée initialement par l’extrême-droite, mais celle-ci a surfé dessus.
Matthijs Gardenier, Vigilantisme et idéologie de la sécurité, des voisins vigilants aux groupes anti migrants, éditions Liber, 24 euros. L’auteur viendra présenter son ouvrage le jeudi 27 novembre à 19 heures à la librairie montpelliéraine la Symbolique du poulet (13 rue des Soldats).
Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :
ARTICLE SUIVANT :