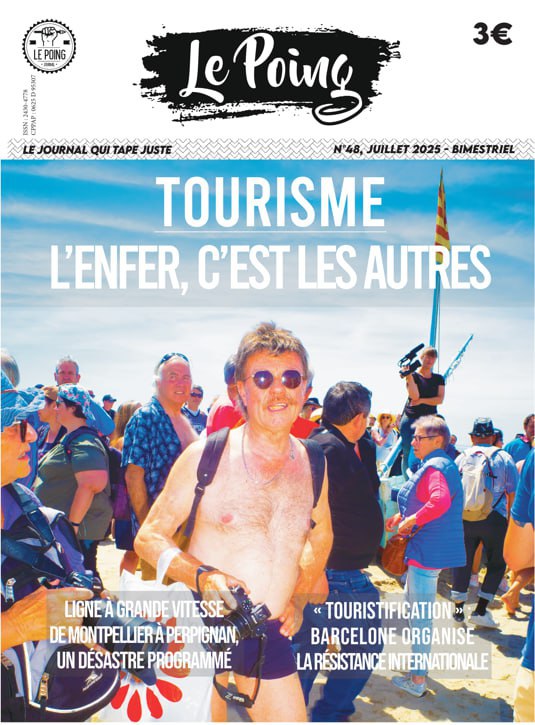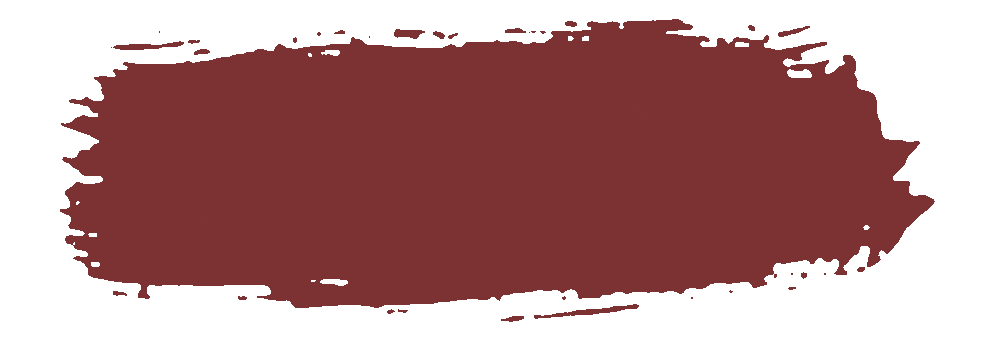La chronique littéraire d’Eugène : « Que fait la police ? Et comment s’en passer ? »

Le militant de la première Internationale et communard Eugène Varlin n’est pas mort, et il a décidé de continuer son engagement en synthétisant des ouvrages de sciences sociales pour Le Poing ! Aujourd’hui, premier résumé du livre de l’économiste Paul Rocher : « Que fait la police ? Et comment s’en passer ? » aux éditions La Fabrique (2022)
« La police n’empêche pas le crime (…) C’est un mythe. » écrivait le politologue américain David H. Bayley dans The Police for the Future en 1996. C’est par cette citation que l’économiste belge Paul Rocher commence son essai. Ce petit ouvrage souhaite briser les mythes autour de la police et rétablir une certaine réalité, chiffres à l’appui.
La droite et l’extrême-droite, de Macron à Zemmour , se font les défenseurs inconditionnels de l’institution, niant toutes dérives et violences policières.La « gauche » réformiste et le communisme version Charal de Roussel reconnaissent certaines défaillances mais croient que la police est réformable, moyennant quelques efforts sur la formation, sur les moyens, sur le recrutement et surtout sur la « proximité » avec la population.
En réalité, l’opinion publique française est dans une impasse cognitive. La police rassure sans assurer d’une quelconque baisse des crimes et délits. Ce mythe à un coût humain élevé car plus les policiers interpellent et arrêtent, plus ils recourent à la force létale légitimée par le simple port de l’uniforme et une économie politique particulière. Les abus et les actes discriminants ne sont pas le fait de « brebis galeuses » mais résulte d’une véritable institutionnalisation.
Et pourtant, les délits et crimes baissent de façon constante depuis les 30 dernières années. La France, autrefois révolutionnaire et explosive, est même devenue un pays étrangement calme malgré la montée des injustices sociales et les provocations liberticides du gouvernement Renaissance. Le macronisme ne cesse cependant d’accroître l’emprise policière sur la société pour réorganiser autoritairement le pays.
La police apparaît en France, comme dans de nombreux pays capitalistes, dans la seconde moitié du XIXe siècle. Force publique professionnelle distincte du reste de la société (au contraire des gardes nationaux composés des citoyens), elle naît avec le capitalisme dans le but de maintenir un ordre injuste et de mettre au pas le prolétariat. Si les policiers sont parfois « en colère » et ont des discours factieux, leur colère est le plus souvent inoffensive pour l’ordre bourgeois.
Les origines capitalistes de la police
La police est liée au rapport social de propriété bourgeoise et au maintien de la domination socio-économique de la bourgeoisie. S’étant approprié les moyens de production comme la force de travail, les capitalistes doivent intensifier l’exploitation des travailleurs tout en évitant leur révolte légitime.
La France pré-capitaliste
Sous l’Ancien-Régime, l’appareil policier recouvrait des missions très différentes de celles d’aujourd’hui. Pour paraphraser Foucault, la police prenait soin des âmes (religion, morale), du corps (nourriture, santé, logement, habillement), de la richesse (industrie, commerce, main d’œuvre) et d’un large pan de la gestion municipale (voirie, déchets, sûreté, éclairage…). Les usages coutumiers organisaient cette « police ».
Jusqu’aux années 1850, les « bourgeois » étaient en fait des notables urbains ou des hauts-fonctionnaires dont le but était de monopoliser les hautes fonctions de l’État et d’accumuler des rentes. Les ouvriers étaient autonomes en louant leur force de travail, ce qui leur permettait de garder un certain contrôle sur leur rythme et organisation de travail. Payés à la pièce, le patronat peinait à leur imposer une discipline rigide.
Ainsi naquit l’idée d’une police moderne, « publique, spécialisée et professionnelle ». En 1829 apparut l’uniforme pour la Police de Paris. Dans les années 1850, on ajouta dans la capitale la pratique de l’îlotage. Mais il n’y avait aucune école ni formation. On recrutait des militaires aux mœurs douteuses qui utilisaient le clientélisme dans les quartiers dont ils avaient la charge.
Et pourtant, les vagues d’effervescence révolutionnaire poussa l’État sous Napoléon III à grossir l’appareil coercitif, notamment dans les villes ouvrières. La police s’étoffe dans toutes les villes tandis que les gardes champêtres se généralisent dans les villages. Cependant, l’armée comme les gardes nationaux restent centraux dans le maintien de l’ordre jusqu’aux années 1870.
La transformation capitaliste
C’est l’année 1852 qui marque le basculement de la France dans le capitalisme avec la création du Crédit mobilier, engagé dans le financement des projets industriels. L’État va alors, au nom de la concurrence et du libre-échange, démanteler toutes les réglementations locales et régionales qui protégeaient les travailleurs. La Cour de Cassation va neutraliser progressivement le bilatéralisme des contrats et consacrer la légalité de l’arbitraire patronal.
Les années 1870-1880 marquent la concentration des moyens de production dans les grandes usines. L’idée est de couper les ouvriers du monde rural et de les rendre dépendants du salaire. La solidarité rurale d’interconnaissance brisée, les ouvriers n’ont pas d’autre choix que de travailler dans l’usine géante pour gagner un salaire de misère (parfois compensé par de nouveaux illégalismes de subsistance extra_salariale comme les trafics illégaux, le crime organisé…).
Face aux « classes dangereuses », la police moderne apparaît dans les années 1880. Les agents doivent désormais suivre une formation professionnelle écrite et théorique d’une ou deux années. Les traitements sont échelonnés, la montée en grade possible et la protection sociale plus développée. La Police se différencie du reste de la société tout en s’homogénéisant en interne. Elle devient une « citadelle assiégée » face à un peuple considéré comme une force ennemie.
Les colonies vont servir de laboratoires. Les forces de police métropolitaines vont s’inspirer des pratiques coloniales de répression (notamment contre les mouvements indépendantistes) pour réprimer les mouvements ouvriers et révolutionnaires. Le Préfet Lépine (nommé en 1893) va lors construire le mythe policier pour « faire aimer la police » à coup de construction d’histoires aussi dramatiques que fausses (mais médiatisées dans la presse grand public).
L’emprise policière
Des dépenses de plus en plus importantes
Les policiers seraient en sous-effectif, mal équipés et surtout pas assez formés. Cela expliquerait pour les libéraux de Renaissance ou la gauche molle la hausse des violences. Il suffirait de payer pour la police ! Cette approche se base sur des données statistiques partielles et des témoignages éparpillés de policiers « en colère ».
En réalité, les dépenses pour la police ont augmenté de 35 %, largement plus que celles de l’éducation. Les effectifs, eux, ne cessent de franchir des records notamment depuis l’arrivée au pouvoir de Macron. La France a désormais plus de policiers par habitant que la RDA ! De même, les policiers sont en moyenne mieux rémunérés que les autres fonctionnaires à catégorie égale, notamment depuis la crise des Gilets Jaunes.
Le recours accru aux armes “non-létales”
Paradoxalement, une baisse des effectifs touche les forces mobiles (CRS et gendarmerie mobile) mais elle est « compensée » par le recours accru aux trop connues unités non-spécialisées (BAC et BRAV-M). Peu formées au maintien de l’ordre, ces forces usent sans retenue des armes non létales.
Quand à la réputation modérée de la gendarmerie, les récentes interventions sur les ZAD (Sivens, N.D des Landes, Sainte Soline…) et certaines free parties (comme celle de Redon en juin 2021) ont été de véritables « chasses aux lapins » avec un recours immodéré aux armes non létales.
La hausse spectaculaire des tirs permet de diminuer la formation en maintien de l’ordre et surtout une diminution numérique sur une courte période.
Une police sur-équipée
Les capacités d’intervention sont également renforcées, qu’il s’agisse des armes, munitions, habillement, protections et véhicules. 2015 marque le doublement du budget des dépenses en équipement. Les commandes en armes et munitions non-létales, notamment depuis la nomination de Darmanin à l’Intérieur, contribuent à accroître leur usage et à déresponsabiliser les policiers. Ces armes ne tuent pas, elles peuvent être utilisées à outrance !
La caméra-piéton pose également problème. Elle favorise le fichage et la mise en ligne de vidéos par les policiers. Par les ajustements d’angles et l’obstruction des champs, les images peuvent être manipulées contre les interpellés. On comprend mieux cette volonté des syndicats policiers et du Ministère de l’Intérieur d’interdire de filmer les violences policières (quitte à violenter les reporters eux mêmes).
La technopolice
La police prédictive, expérimentée depuis des décennies aux USA, tentent aussi de percer en France. Par des algorithmes, la technopolice cible prioritairement les quartiers pauvres aux potentialités de criminalité plus élevées. Le recours à la force sera plus fréquent dans ces zones car le soupçon pèse sur l’intégralité de la population (souvent racisée) s’y trouvant. Les patrouillages excessifs gonflent les arrestations et ne font que déplacer la délinquance ailleurs.
Cette technopolice intéresse l’État et surtout les industriels des domaines tels que l’IA, la biométrie, la reconnaissance faciale, vocale et olfactive ainsi que la réalité augmentée. Sous le prétexte de lutter contre le terrorisme, leur activité de surveillance des mouvements sociaux (« anarcho-autonomes », « éco-terroriste »…) a crû rapidement depuis 2015.
L’emprise policière croissante
La police municipale a également triplé ses effectifs depuis 1990. Avec des missions de plus en plus larges, elle permet de décharger la police nationale d’une partie de ses tâches quotidiennes.
Les entreprises de sécurité privée, héritières des milices patronales des années 1970, sont également considérées comme des forces supplétives de police. Omniprésentes ( y compris dans les universités ! ), elles recrutent leurs gros bras dans les milieux d’extrême-droite.
La population est de plus en plus associée à ce travail de « vigilance » ou plutôt de surveillance mutuelle. Cela brise le développement de pratiques collectives. La délation (comme par exemple les signalements sur Pharos) est valorisée par les pouvoirs. Cela déculpabilise le dénonciateur anonyme convaincu ainsi de faire une bonne action. Cela permet également de repérer dès la maternelle les « déviations » et « radicalisations ».
Une police surdimensionnée
Un pays qui se tient sage
La police serait privilégiée par les gouvernements successifs à cause de l’ « ensauvagement » et même de la « décivilisation » du pays.
Or, les enquêtes de victimisation prouvent que la France est de plus en plus calme. Les chiffres du Ministère de l’Intérieur sont basés sur des requalifications de contraventions en délit et la création de nouvelles incriminations.
La politique du chiffre pousse les commissariats à embellir les statistiques quantitatives pour justifier leurs performances. Ce zèle concerne évidemment les crimes et délits commis par les personnes racisées de quartiers populaires. Les crimes et délits des riches et des beaux quartiers sont sous-estimés. Les classes populaires « dangereuses » sont opposées à la supériorité morale des plus riches.
Un racisme institutionnel
Selon l’auteur, 95 à 97 % des contrôles touchent aujourd’hui des personnes n’ayant rien à se reprocher, hormis leur couleur de peau. Le contrôle au faciès instaure ainsi un pouvoir discrétionnaire de la police pouvant conduire au « harcèlement discriminatoire » des non-Blancs dans certains quartiers. Si les policiers ne sont pas tous racistes, il existe un « habitus institutionnel », un racisme routinier allant de soi dans les commissariats.
En effet, les « solutions » visant à recruter plus de « diversité » et à améliorer la formation des policiers se révèlent quasi-nulle puisque ce racisme institutionnel affecte « a minima » de manière inconsciente l’ensemble des agents qui y voient un fonctionnement normal de leur institution. Alors que des vidéos et enregistrements attestent de ce racisme (notamment dans la BAC et la BRAV M), le discours officiel fustige des brebis galeuses pour relativiser la gravité des faits.
Le gouvernement de Macron fait preuve sur cette question d’un cynisme politique absolu pour quérir les voix d’extrême-droite et d’une partie des « boomers ». On stigmatise une partie de la population (la jeunesse populaire des cités) en criminalisant les associations antiracistes comme la LDH. Parallèlement, on ne mène aucune politique antiraciste dans la police en avouant qu’elle est à l’image de la société…
Un sexisme omniprésent
Selon l’enquête « PayeTaPlainte » menée en 2018, les femmes victimes de violences sexistes subissent très souvent une humiliation lors de leurs plaintes en commissariat. Les femmes arrêtées peuvent également être la cible de violences sexistes dans les commissariats (notamment lors des GAV). En effet, le patriarcat est ancré au sein de la police qui attire des profils autoritaires et virilistes (courants dans les milieux d’extrême-droite).
La « gestion » de l’ordre social
On constate depuis 2018 (le moment Gilet Jaune) une multiplication par 9 du recours aux armes non-létales. Entre novembre 2018 et mars 2020 (début de la pandémie), il y aurait eu 24 300 blessés dont 3000 nécessitant une prise en charge d’urgence. Ces chiffres épouvantables sont connus grâce à l’action des journalistes indépendants, street medics et collectifs militants. Le Ministère de l’Intérieur ne communique, lui, que sur les policiers et gendarmes blessés.
Les actes de violence policière sont rarement condamnés tandis que les mises en cause de citoyens innocents explosent, notamment les GAV abusives lors des manifestations. Les GAV sont 2 fois supérieures aux mises en cause et 9 fois supérieures aux incarcérations. Les syndicats policiers expliquent ce décalage par le « laxisme » des juges. En fait, les procédures sont irrégulières et les preuves insuffisantes. La fabrique du chiffre ne peut pas convaincre les magistrats !
En réalité, les affaires criminelles n’occupent que 10 % du temps de travail des policiers. L’essentiel du travail policier est le maintien de l’ordre moral bourgeois et capitaliste. Cela peut être des missions légitimes comme la régulation du trafic routier, la gestion des conflits de voisinage et domestiques. Mais de plus en plus, la police concentre ses efforts sur les rassemblements publics, les migrations clandestines, les renseignements administratifs et la surveillance politique.
Forme Police, forme État
La police forme probablement le corporatisme le plus homogène et puissant de France. Le syndicalisme policier revendique toujours plus de capacités d’intervention violentes avec des éléments de langage parfois néofascistes (74 % des policiers votent pour un parti d’extrême-droite !). Les médias comme les pouvoirs politiques font preuve de bienveillance face à cette institution, reprenant sans scrupule les communiqués des syndicats policiers !
Une citadelle assiégée
Assiégés, les policiers sont très soudés face à une population vue une menace potentielle. Les militants (écologistes, syndicalistes, Gilets Jaunes…) sont vus comme des « casseurs », les populations non-blanches des quartiers comme des « racailles ». Ainsi, les syndicats de police doublent l’État sur sa droite autoritaire.
Cet État, vu comme neutre par les experts les plus médiatiques, n’est pas étranger aux intérêts capitalistes. L’État monopolise grâce aux forces de l’ordre la contrainte physique. Il utilise cette dernière pour réguler le marché et assurer sa perpétuation. En effet, l’État moderne a besoin du capitalisme pour exister car ce système économique lui assure des ressources. La police assurant l’ordre établi est donc capitaliste structurellement.
L’offensive néolibérale
Durant les mal-nommées « 30 Glorieuses », l’État a du faire face à un rapport de force plus favorable aux travailleurs. Dans les années 1970, la classe dominante abandonne brutalement toute stratégie d’alliance avec les « classes moyennes ». L’État se radicalise parallèlement avec des formes d’étatisme autoritaire (hypertrophie du pouvoir exécutif, mépris du travail législatif, politisation de la haute administration…).
L’absence de consentement des masses sur la contre-révolution néolibérale rend la police indispensable pour le pouvoir bourgeois. En effet, les troubles sociaux ont des conséquences néfastes sur l’accumulation de capital et peuvent entraîner des crises. C’est pourquoi il y a une « solidarité étatique » entre l’État et sa police.
Une institution imperméable
La police attire des profils autoritaires fascinés par la conception purement répressive du métier. La police est marquée par un esprit de corps et une solidarité horizontale entre pairs très importants. L’école de police produit un « repli clanique ». A ce conformisme s’ajoute une fascination pour l’expérience des formateurs et un goût pour l’autoritarisme exacerbé.
Les comportements violents sont de plus en plus liés à la recherche « d’efficacité » (primant sur le respect de la loi). Ces brutalités sont tellement banales qu’elles ne sont quasiment jamais sanctionnées, les victimes n’arrivant le plus souvent pas à obtenir justice. L’omerta règne face aux abus et les policiers un peu trop critiques risquent des sanctions.
Une ambiance extrémiste
Votant à 74 % pour l’extrême droite, les policiers sont parfois des agitateurs d’extrême-droite. Racistes envers les « racailles » des cités, ils cultivent également une haine pour les « casseurs » bobos et gauchistes. Un héritage colonial existe dans la police depuis les Guerres d’Indochine et d’Algérie et permet quelques contournements de procédure pénale et actions illégales contre les populations racisées et les mouvements sociaux.
Un loyalisme vis à vis de l’État
La révolte des vignerons de 1907 durant laquelle plana le spectre des fraternisations explique la mise en place d’unités spécialisées dans le maintien de l’ordre et l’obligation d’intervenir à l’extérieur de leur propre zone de cantonnement. Les terribles grèves ouvrières de 1947 permirent également de purger les compagnies de CRS des éléments communistes issus de la Résistance.
La police est donc aujourd’hui d’une loyauté robuste envers l’État capitaliste. La moindre éventualité de jonction entre policiers et mouvements sociaux est prévenue par de lourdes sanctions et des réorganisations rapides. Les « policiers en colère » ne menacent pas l’État mais jouissent même du soutien tacite du Ministère de l’Intérieur.
Ces « grèves » policières demandent tout simplement plus d’équipements, plus de facilités d’user de la force et de contourner les procédures pénales. Gare à ceux qui oseraient attaquer l’institution ! C’est ainsi que les mouvements factieux de policiers se multiplient devant des sièges de partis politiques (LFI en 2019), des médias (Radio France en 2020) ou même l’Assemblée (2021) !
Ce loyalisme est récompensé par le Ministère de l’Intérieur qui ferme les yeux sur les débordements illégaux de la police. Les violences contre les journalistes, « l’oubli » du RIO ou les interpellations abusives prouvent en effet que les lois et les règles sont bien secondaires pour les forces de l’ordre. L’ordre doit primer sur la légalité ; il devient même la loi !
Jalons de l’ordre populaire
La police est donc utilisée par l’État capitaliste pour justifier sa propre violence vis à vis des travailleurs et classes populaires. Il apparaît donc illusoire de vouloir la réformer car elle défend et incarne l’ordre social. L’État ne laissera jamais dissoudre sa police sans opposer sa force.
Défaire la police permettrait de faire disparaître une partie des tensions générées par la seule présence de l’institution. Cela permettrait également la réallocation des crédits de police vers l’emploi, la santé, l’éducation ou le logement (le bien-être du plus grand nombre).
Sans police, l’État serait obligé, selon l’auteur, d’être plus attentif à la société civile et aux revendications sociales et démocratiques. La nouvelle régulation ancrerait organiquement l’ordre sans la société civile : rotation pluri-annuelle des citoyens, responsabilité et compte-rendus, voie de recours direct en cas de manquements.
Eugène Varlin
Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :
ARTICLE SUIVANT :