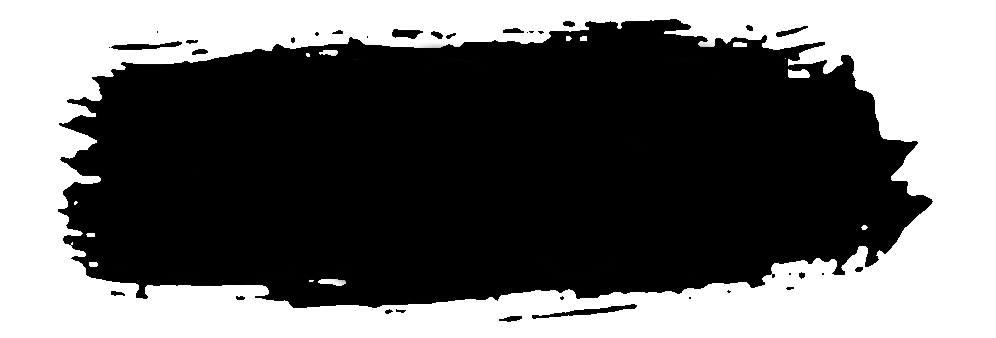Montpellier : un procès pour Adrien, ouvrier blessé à vie par les ravages du capitalisme

Les cordistes travaillent à grande hauteur, souvent en statut précaire et au détriment des consignes de sécurité. La Cour d’appel de Montpellier vient d’examiner à fond un très grave accident survenu à Sète, après que la victime ait dû attendre dix ans de procédure ! Mais rien ne prévoit d’instruire le procès de la course aux profits, qui est la clé du problème
Dix ans. C’est ahurissant. Adrien Santoluca a dû attendre dix ans pour que soient définitivement jugées les responsabilités dans l’accident du travail qui lui a bousillé la vie. Il aura fallu qu’il s’intéresse aux procédures de recours contre les délais judiciaires abusifs, pour voir enfin son affaire jugée en appel à Montpellier ce lundi 6 janvier 2025. « Quand on est un ouvrier, tout paraît opaque, insurmontable, dans ces procédures », nous confie-t-il en constatant : « Je n’ai pas encore quarante ans, et mon corps lâche de partout ».
Depuis son accident survenu le 14 septembre 2015, sur le port de Sète, bassin en miettes, fracturé de partout après une chute de quasiment dix mètres de hauteur, il ne compte plus les mois d’hospitalisation, puis en établissements de rééducation, en mobilité réduite sur fauteuil, puis sur béquilles, infections surajoutées, opérations à répétitions, retour à l’emploi momentané, puis nouveaux congés maladie. En ce moment c’est à ce titre, avec 600 euros mensuels qu’il survit, à peine améliorés de quatre euros par jour de pension d’invalidité.
Son jugement – qui sera rendu le 3 mars prochain – il le lui faut pour espérer rentrer pleinement dans ses droits à réparation. Dix ans, les délais de l’institution judiciaire, ne sont vraiment pas ceux de la vraie vie des vrais gens. Quatre heures. Quatre heures d’examen minutieux et de débats contradictoires : au moins Adrien Santoluca aura-t-il pu apprécier, ce lundi devant la Cour d’Appel de Montpellier, que son affaire n’y a pas été traitée à la va-vite, par un président d’audience particulièrement méticuleux. Et souvent pugnace.
Reste que les hommes de loi s’en tiennent à la loi. Dans ce cas : déterminer strictement les responsabilités dans l’accident gravissime dont Adrien Santoluca a été victime. Ce 14 septembre 2015, il travaille sur le toit d’un immense hangar, vétuste, sur le port de commerce de Sète. Il doit appliquer une résine sur des fissures des plaques de micro-ciment, quand l’une de celles-ci craque soudain sous son poids, provoquant sa terrible chute.
Sur ce chantier, cet ouvrier cordiste ne bénéficie d’aucun équipement de sécurité, ni collectif, ni personnel. Pas même une corde, qui est à la base de son métier. A qui la faute ? Des heures durant à l’audience, les juges et avocats, Sébastien Gimar gérant de la société Sud Acrobatic qui effectue ce chantier, et enfin l’ouvrier victime, en auront discuté. Cela avec pour boussole, juridique, la détermination de ce que prévoit la loi, et ce qui s’est produit, qui enfreint cette loi.
Cette loi – le code du travail – ne semble pas si mal faite, qui fixe tout un tas d’obligations de sécurité. Par exemple : Adrien Santoluca œuvrant là sous le statut d’intérimaire, il aurait dû être encadré par un employé permanent de la société de travaux de grande hauteur, qui serait susceptible de peser dans certains choix relatifs à la sécurité. Or ce binôme était tout autant extérieur à l’entreprise, puisque travaillant, lui sous le statut d’auto-entrepreneur. Puis on examine le plan de prévention des risques, cosigné par toutes les sociétés impliquées – dont le gérant de Sud Acrobatic – ou encore la fiche d’intervention établie en interne pour ce chantier.
Sur le papier, tout semble prévu, les cases sont cochées, tout est paraphé, signé. Il faudrait installer un échafaudage, une main courante (à l’image des via ferrata), une ligne de vie, bref une corde solidement arrimée à des points d’ancrage, qu’il faudrait donc installer, il faudrait envisager un filet de sécurité, on mentionne aussi une nacelle à disposer en dessous du point d’intervention sur le toit.
Au final, aucun dispositif n’est en place : « On a l’impression que ces documents signés sont des espèces de décharge de responsabilité. Il suffit que ce soit écrit sur la fiche de chantier, pour qu’on s’en lave les mains » s’étonne la conseillère rapporteure. Et le président de la Cour, mettant souvent le gérant de la société en difficulté : « Il y a là des dispositions illégales flagrantes. Vous vous mettez dans l’illégalité, en pleine connaissance de cause. Et c’est de votre responsabilité de chef d’entreprise ».
Lequel – omettant la moindre parole de regret ou de compassion pour la victime – renvoie toute la responsabilité sur les ouvriers eux-mêmes : « Absolument tout le matériel nécessaire à la mise en place de sécurités était disponible, dans leur fourgon ». Mais alors, comment expliquer que rien ne soit mis en place dans les faits, et que ce gérant ne s’en soucie pas ? Le président du tribunal a son idée : « La sécurité a un coût. Plus les précautions seront élevées, plus votre devis le sera. Alors, vous signez, vous signez. Mais il ne faut pas perdre le marché ».
Là, on commence à entrer dans la logique du marché. La loi du profit. Le moteur du capitalisme. S’intéresser au côut. Non à la sécurité. Mais voilà qui dépasse la logique à discuter dans l’enceinte judiciaire. On se pose encore cette autre question : le gérant jure qu’il « ne s’explique pas que l’ouvrier ait pu s’engager sur le toit sans aucune protection de sécurité ». Un conseiller de la Cour a son idée : « sans doute un ouvrier intérimaire qui refuse d’effectuer un travail pour des raisons de sécurité est-il un ouvrier qui perd son travail ? ».
Mais y a-t-il des lois pour préciser cela ? Il y a en tout cas les déclarations de la victime pour décrire beaucoup mieux cette réalité : « En fait, ce qui s’est passé dans ce cas se passe partout pareil. Ces sociétés sont censées être très spécialisées, pour des chantiers très exigeants, très particuliers. Dans les faits, on appelle les cordistes pour effectuer des choses que personne d’autre ne veut faire. On y met des précaires, à 10,50€ de l’heure, sans même de prime de risque, après une formation de cinq semaines, et sans qu’on puisse influer sur la moindre décision. On joue à la roulette russe tous les jours ». Décidément inspiré, le président aura ce mot pour le gérant : « Les gens que vous employez, ce sont des ouvriers ? Ou des cascadeurs ? »
Tout cet après-midi, Adrien Santoluca n’aura pas été seul, entouré par des membres de l’association des cordistes en lutte. Tous convaincus d’être victime d’un système d’exploitation généralisée, dans un secteur d’activité, le bâtiment, soumis à tous les dérèglements, précarités, concurrences acharnées, arrangements de tous côtés ; et non de négligences juste ponctuelles sur tel ou tel chantier.
Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :
ARTICLE SUIVANT :