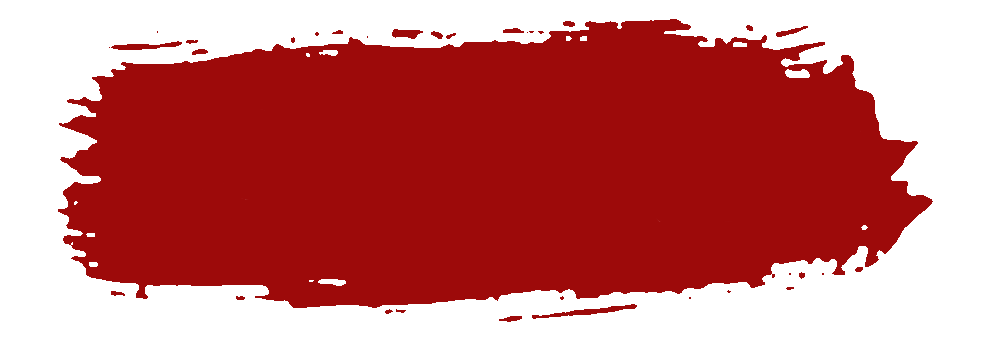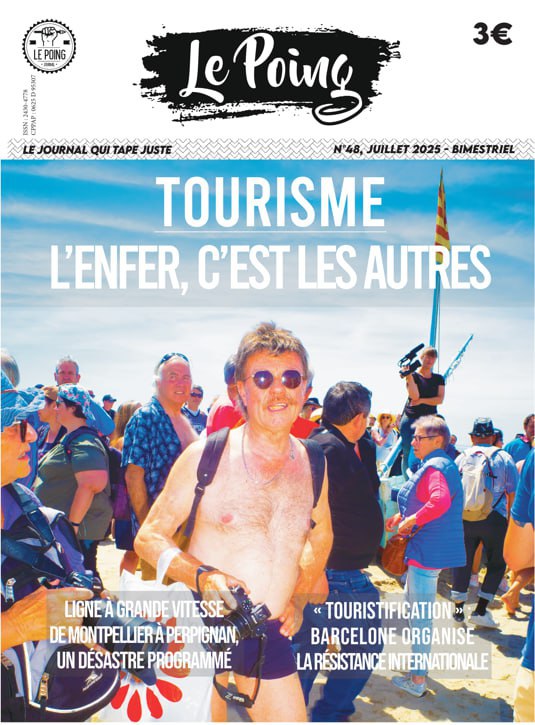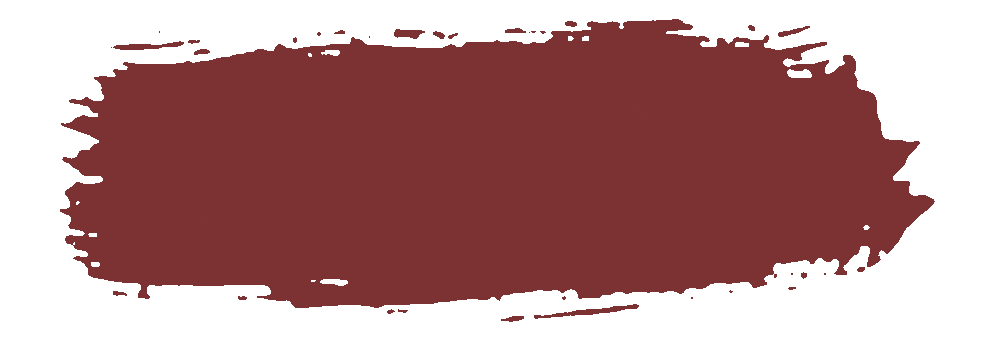D’Action Directe aux Gilets jaunes : une histoire de l’autonomie avec Arthur Pouliquen
Dans son ouvrage “Le monde ou rien. Histoire du mouvement autonome en France“, riche en références et anecdotes (notamment montpelliéraines), le chercheur en sciences politiques Arthur Pouliquen retrace un demi-siècle de luttes, de squats et d’affrontements, depuis les années 1970 jusqu’aux Gilets jaunes. À travers cette enquête, il interroge la portée politique d’un courant méconnu et souvent diabolisé : celui qui revendique l’autonomie comme manière de vivre et de lutter
Le Poing : qu’est-ce qui t’as poussé à écrire un livre sur le mouvement autonome ?
Arthur Pouliquen : Cela vient d’une frustration de ne pas trouver d’histoire globale du mouvement. En passant d’une librairie à l’autre, je me suis rendu compte qu’il y avait soit des bouquins de journalistes assez sensationnalistes sur le black bloc du genre “pourquoi ils cassent tout ?”, ou des livres d’universitaires très précis qui touchaient à un seul aspect du phénomène. J’ai donc décidé d’en retracer une histoire globale.
Le Poing : quelle méthodologie as-tu adoptée pour enquêter sur un courant aussi méfiant vis-à-vis des institutions, y compris des chercheurs ?
A. P. : J’ai lu ce qu’ils écrivaient, dans des journaux des années 70 ou 80, compilés sur des sites comme archives autonomies, qui m’ont été très précieux. J’ai aussi regardé des documentaires, des chroniques judiciaires, des récits faits par leurs adversaires ou concurrents politiques, ainsi que des entretiens avec des gens qui ont participé soit récemment soit il y a quelques décennies au mouvement. J’ai aussi étudié des tracts, affiches, compilés sur les quinze dernières années.
Le Poing : ton livre s’intitule Le monde ou rien. Pourquoi ce slogan, et que dit-il de la philosophie du mouvement autonome ?
A. P. : C’est une référence à une chanson de rap du groupe PNL, qui est apparue sur une banderole en 2016, pendant la loi Travail, qui a été le point culminant du mouvement en France au XXIe siècle. Cela montre l’aspect maximaliste qui caractérise le mouvement : ça dit clairement “on ne va pas se contenter des miettes, de simples réformes, on veut tout changer, prendre d’assaut le monde entier.”
Le Poing : Le terme “autonome” est souvent flou, voire galvaudé. Quelle définition en donnes-tu dans ton ouvrage ?
A. P. : C’est difficile, car des personnes s’en revendiquent sans y appartenir, et des autonomes ne revendiquent pas cette appellation. C’est avant tout une position extrême par rapport au reste des révolutionnaires, à la gauche et aux institutions : construire ses propres forces en dehors des partis, syndicats… Cela passe par un ensemble de pratiques : assumer un certain degré de violence politique, le refus des formes d’organisation de type syndicales, des pratiques d’occupations, de production de ses propres médias… Ces pratiques, prises chacune séparément, ne suffisent pas à définir le mouvement, mais toutes ensemble, mises au service de revendications maximalistes, elles permettent de définir l’autonomie.
Le Poing : Tu montres dans ton livre qu’il est difficile de trouver une homogénéité, aussi bien théorique que pratique, dans l’autonomie…
A. P. : On parle d’un ensemble multiple et très fragmenté, de collectifs, de groupes, de publications… On a des groupes de différentes sensibilités au sein de l’autonomie qui peuvent entrer en concurrence, s’affronter… Si on faisait une typologie, on aurait, à notre époque, trois grands courants de l’autonomie en France : Premièrement, l’autonomie marxiste, le canal historique, qui va se revendiquer par exemple de la pensée de Rosa Luxembourg. Ses militants vont beaucoup insister sur l’autonomie de classe. Ensuite, la grande majorité de l’autonomie d’aujourd’hui est issue de la pensée anarchiste, qui ne se retrouve pas dans les organisations anarchistes, qui sont plutôt en train de péricliter. Les pratiques tournent autour des occupations, des squats, influencées par l’esthétique punk par exemple. C’est la forme d’autonomie la plus perméable aux autres luttes comme l’écologie ou le féminisme. Enfin, il y a l’appelisme (nom qui vient de L’appel, texte de 2004), qui est un courant à part, typiquement français, avec son lyrisme politique.
Le Poing : quels sont pour toi les moments fondateurs de l’autonomie en France ?
A. P. : La première vague se situe entre 1974 et 1981, avec des groupes inspirés notamment par l’opéraïsme, très liés au mouvement squat, aux luttes des sidérurgistes de l’époque. Cela va s’arrêter quasi-complètement avec l’élection de François Mitterrand en 1981. Une deuxième vague réapparait avec le mouvement des chômeurs de 1994, et après, autour de 2005 et 2006, avec les émeutes des banlieues puis le CPE. Les moments-clés les plus récents de l’autonomie se situent entre 2016, avec la loi Travail, et 2018-2019, qui marquent la fin de la ZAD de Notre-Dame des Landes. C’est assez intéressant, car dans les 80, un gouvernement de gauche arrive au pouvoir, et le mouvement révolutionnaire se fait institutionnaliser ou isoler, et dans les années 2010, on a une longue construction d’un mouvement déçu par ces gouvernements socialistes, avec des arrières-bases solides comme la ZAD. Cela permet au mouvement autonome de ressurgir en 2016, notamment dans les grandes villes.
Le Poing : Quelle(s) différence(s) fais-tu entre les autonomes des années 70, ceux des années 90 et les autonomes actuels ?
A. P. : Le mode de vie des autonomes des années 70 est beaucoup plus difficile à vivre aujourd’hui : ils vivaient dans une semi-clandestinité permanente. Au-delà des squats, c’était des faux papiers, des faux traveller’s chèques, le vol systématique, les braquages… Les mouvements contre-culturels punk des années 90 ont aussi quasiment disparu. Globalement, le niveau de violence a radicalement baissé, dans les années 70, les autonomes étaient armés et pratiquaient le braquage ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.
Le Poing : Tu montres que la question de la violence est centrale pour comprendre l’autonomie. Quelle est, selon toi, la logique politique derrière l’affrontement avec la police ou la destruction matérielle ?
A. P. : Cela se justifie par la pensée anarchiste traditionnelle et la pensée des années 70, notamment Foucault avec la notion de bio-pouvoir. C’est l’idée qu’on vit dans une société qui exerce un contrôle de plus en plus fort sur les individus, les corps, les groupes sociaux marginaux, via des représentants très précis : caméras de surveillance, vigile, policiers, magistrats. De fait, s’en prendre à ces symboles constitue un acte politique en soi, ce qui constitue un peu un retour de l’illégalisme anarchiste typique du siècle dernier. Le risque, c’est de s’enfermer dans une fuite en avant, un combat forcément perdant contre l’Autorité avec un grand “A”.
Le Poing : Penses-tu que la défaite des mobilisations sociales et la répression des mouvements autonomes — notamment après 2016 et 2018 — a contribué à les radicaliser davantage ou à les disperser ?
A. P. : Un peu les deux. Si on définit l’autonomie comme un ensemble de pratiques liées à une position maximaliste, quelque part on comprend que même si ces mouvements se font balayer et que ses militants ne restent pas, le mouvement va se perpétuer même s’il n’a que peu de mémoire de lui-même : dans toute mobilisation de masse, il y aura toujours des gens pour refuser le cadre émanant de syndicats ou d’organisations politiques qui vont se réapproprier cette culture-là. Cependant, on voit que la répression a échaudé beaucoup de militants et a dégarni les rangs.
Le Poing : tu dis de ce mouvement qu’il a assez peu de mémoire de lui-même, pourquoi ?
A. P. : Même si des militants travaillent contre cette tendance en archivant tout dans des bibliothèques ou des médias, le mouvement autonome se caractérise avant tout par un refus de structuration trop importante. Ses collectifs ont donc une durée de vie assez limitée, les militants ayant des impératifs de sécurité les enfermant parfois dans une forme de paranoïa et un certain repli sur soi… C’est donc rare qu’une génération transmette le flambeau à la suivante.
Le Poing : En quoi les expériences de l’autonomie italienne ou de l’autonomie allemande ont inspiré les autonomes en France ?
A. P. : Quand on étudie ces trois pays dans les années 70-80, on se rend compte que la France est le parent pauvre de l’autonomie. Nous on a eu les squats, Action Directe, mais ça reste très marginal par rapport à l’Italie, avec de grands mouvements d’occupations, de grèves sauvages… Des militants italiens réfugiés en France viendront alimenter les débats, avec une reprise de l’héritage marxiste. L’Allemagne va ensuite influencer la France en matière de pratiques d’occupations, de contre-culture… Il y a toute une vague d’importation de pratiques, notamment celle du “bloc noir”, appelé plus tard black-bloc, que les autonomes allemands pratiquent beaucoup.
Le Poing : Tu évoques la dimension existentielle du mouvement : squats, fêtes, refus du travail, entraide… En quoi ces pratiques constituent-elles une politique à part entière ?
A. P. : L’idée des autonomes, c’est que la politique révolutionnaire, c’est la politique de la vie quotidienne. On sent vraiment la filiation situationniste : c’est par le refus du travail, la vie communautaire, qu’on va sortir de l’aliénation, pas en attendant un hypothétique grand soir. C’est intéressant dans la radicalité des positions que cela permet de développer, mais en même temps, cela conduit à des mouvements qui risquent de tomber dans la marginalité, voire de virer à l’alternativisme, donc à l’abandon d’une perspective révolutionnaire.
Le Poing : Où situerais-tu l’autonomie dans le paysage militant contemporain, entre écologie radicale, antifascisme, et mouvements queer ou décoloniaux ?
A. P. : L’autonomie entretient des ponts avec toutes ces luttes, mais pas à l’intersection, plutôt dans les périphéries. Des militants autonomes peuvent participer à ces luttes, s’en nourrir, et ces luttes peuvent se nourrir de pratiques autonomes. L’autonomie a été beaucoup alimenté dans les années 2010 par l’arrivée d’une nouvelle écologie radicale. On l’observe aussi très récemment sur les questions de genre, mais il faut rappeler que dès les années 70, les autonomes s’intéressent à beaucoup de sujets et sont très ouverts sur le monde : féminisme, lutte des immigrés, supporters de foot…
Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :
ARTICLE SUIVANT :