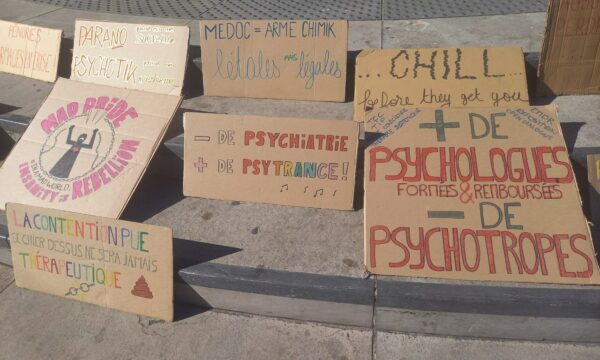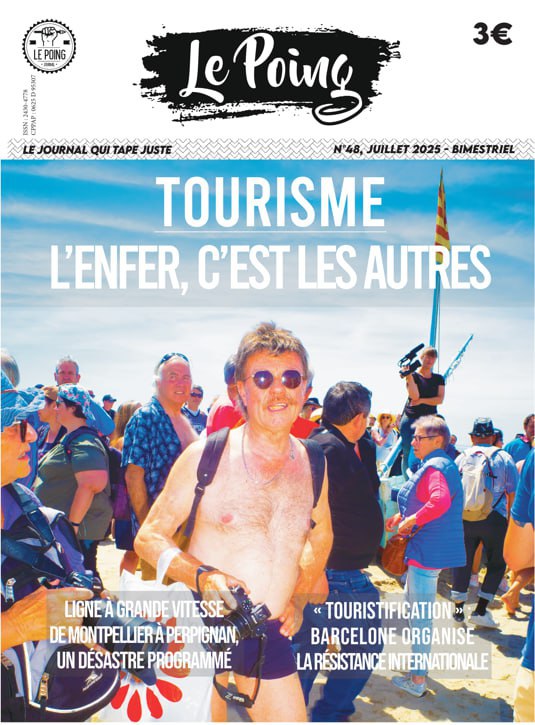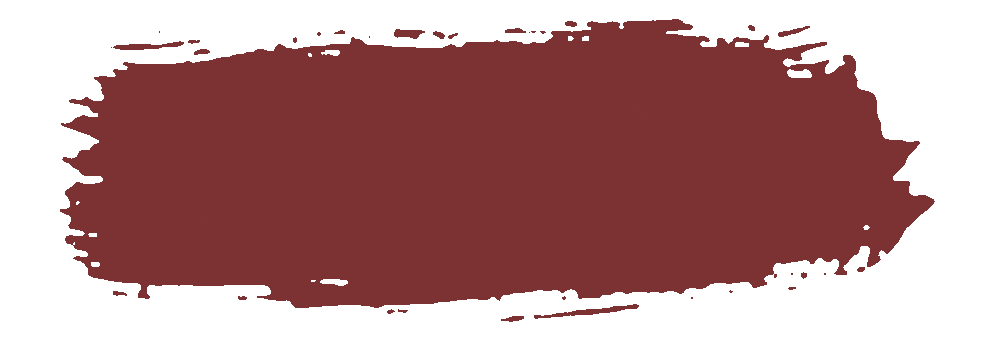Le développement personnel, ce renoncement à changer le monde : entretien avec Damien Karbovnik
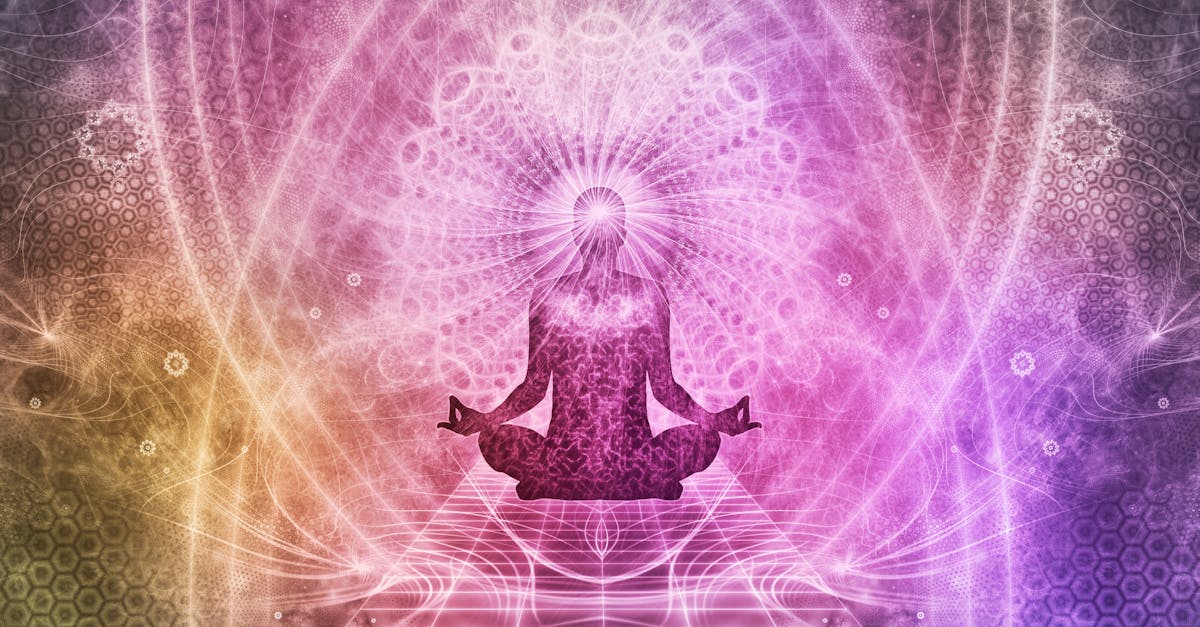
Damien Karbovnik est un sociologue des religions, spécialiste de l’ésotérisme contemporain. Passé par l’Université Paul-Valéry de Montpellier durant sa thèse, il enseigne aujourd’hui à l’Université de Strasbourg. Dans son récent ouvrage “Le développement personnel, nouvel opium du peuple ?”, il démontre que cet ensemble de pratiques en pleine expansion est notamment corrélé à la précarisation de l’emploi ou à l’accroissement des inégalités
Le Poing : Le développement personnel semble englober tout un ensemble de pratiques très hétéroclites, du reiki au coaching en passant par la psychologie positive, comment le définir ?
Damien Karbovnik : Le développement personnel, c’est un ensemble de discours et de pratiques qui partagent une même idée : nous aurions tous en nous un potentiel caché qu’il faudrait libérer pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Peu importe la méthode (méditation, coaching, respiration, chamanisme, …), c’est toujours la même promesse : celle d’une transformation intérieure censée tout résoudre et nous rendre heureux.
Le Poing : sociologiquement, qui sont les gens qui ont recours au développement personnel, et qui sont ceux qui en vivent ?
D. K. : Tout le monde, littéralement. On en fait même faire aux enfants à l’école, sous forme de sophrologie notamment. Ce qui pousse à entrer dans le monde du développement personnel, ce n’est pas tant le milieu social que le sentiment de perte de sens : une rupture, une lassitude, le sentiment que quelque chose s’est déréglé dans sa vie, dans son travail ou simplement en soi.
Par contre ce qu’on observe, c’est qu’en fonction des milieux sociaux, les pratiques ne sont pas les mêmes : Les études montrent, par exemple, que la méditation séduit surtout les cadres supérieurs, mais d’autres pratiques, comme l’astrologie, sont plus universelles. Par ailleurs, beaucoup de pratiques demandent un certain budget ; logiquement, ceux qui s’y consacrent le plus sont donc ceux qui peuvent se le permettre – mais j’ai aussi rencontré des personnes en situation de précarité qui y consacraient tout l’argent qu’ils pouvaient.
Du côté de ceux qui en vivent – ce que j’appelle les “médiateurs” -, le contraste est frappant. On trouve, d’un côté, l’héritier au sens bourdieusien du terme : quelqu’un qui dispose déjà d’un capital économique, culturel et symbolique suffisant pour se “réinventer” sereinement, en se lançant dans la naturopathie ou le coaching. Et de l’autre, des individus en rupture, épuisés par le travail ou par la vie, qui investissent leurs dernières économies dans une formation censée les sauver – mais qui souvent les précarise encore un peu plus.
Ce grand écart dit tout du système : le développement personnel vend la promesse d’émancipation, mais il reproduit les inégalités qu’il prétend dépasser. Et aujourd’hui, le marché est saturé : tout le monde veut aider les autres à “se trouver”, mais plus personne ne sait très bien où chercher sa clientèle. Si bien que de plus en plus proposent désormais des formations pour permettre aux “médiateurs” de devenir… de meilleurs “médiateurs”
Le Poing : Ce livre est le résultat de quinze années de recherches, quelle a été votre méthode d’enquête ?
D. K. : Je suis venu au développement personnel un peu par accident. À l’origine, j’étudiais l’ésotérisme contemporain des années 1960-1970. En suivant le devenir de ses acteurs et de leurs discours, je me suis rendu compte que beaucoup avaient glissé vers ce qu’on appelle aujourd’hui le développement personnel. C’est comme ça que je suis tombé dedans, par continuité plus que par hasard.
J’ai mené beaucoup d’observations participantes : stages, groupes, cabinets de thérapeutes, salons du bien-être… toujours à visage découvert, jamais en infiltration. Je me présentais simplement comme sociologue travaillant sur les formes contemporaines de l’ésotérisme. Et puis j’ai lu, énormément. Des classiques du genre aux derniers manuels à la mode.
Le Poing : C’est un travail qui s’inscrit sur un temps long où vous avez pu suivre des gens sur plusieurs années. Est-ce que cela signifie que le développement personnel est une quête infinie ? Est-ce que des gens en reviennent ?
D. K. : Dès le départ, j’ai vu que les personnes que je rencontrais se projetaient sur le long terme. Elles disaient souvent être “en chemin”, ce qui m’a poussé à vouloir les suivre dans la durée. En pratique, ça n’a pas toujours été simple – on perd vite des contacts, les gens déménagent, changent de vie ou passent à autre chose. Malgré tout, j’ai pu suivre quelques personnes sur une dizaine d’années et en rencontrer d’autres qui fréquentaient ce milieu depuis les années 1970, Ce qui m’a le plus frappé dans leurs récits c’est que le développement personnel n’est pas envisagé comme une pratique stable, mais un mouvement continu. Les gens évoluent, changent de méthode, d’approche, de “maître”. Je les retrouvais six mois plus tard dans un autre stage, et ils me disaient : “ah oui, le truc d’avant, c’était des foutaises”.
Ce va-et-vient permanent donne l’impression d’un travail sans fin. C’est une recherche de soi qui n’aboutit jamais complètement et qui semble se renouveler sans cesse,
Le Poing : Donc le développement personnel, ça “marche” ?
D. K. : C’est la grande question ! Si l’interrogation est “est-ce que ça permet aux gens d’aller mieux ?“, la réponse est oui. Mais la vraie question, ce n’est pas celle-ci. On peut plutôt se demander si le développement personnel tient sa promesse initiale d’aider les gens à exploiter leur plein potentiel : là j’ai envie de répondre, non, personne n’y est arrivé, les gens sont encore en chemin, donc oui, le développement personnel est une quête infinie.
Le Poing : Vous dites dans votre livre que le développement personnel est né comme une réponse critique à la modernité. Mais n’est-ce pas finalement une forme parallèle de modernité ?
D. K. : Cela fait plus d’un siècle qu’on vit avec un grand mythe : celui de la modernité qui aurait remplacé la foi par la raison, et la religion par la science. On a longtemps cru que les progrès scientifiques allaient faire disparaître les croyances.
Alors oui, cette idée tient à peu près quand on étudie le christianisme ou les grandes religions dites “historiques”. Mais dès qu’on s’intéresse à l’ésotérisme, ça ne marche plus vraiment. Lui n’a jamais disparu, au contraire, Plus la modernité avance, plus il s’épanouit. La sécularisation a fait reculer l’Église, mais elle a libéré tout un espace pour d’autres formes de croyance. Et aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, cet univers dispose d’une vitrine mondiale sans précédent.
C’est pour ça que, selon moi, le “désenchantement du monde” dont parlait Max Weber est à prendre avec beaucoup de précautions. La science a répondu à certaines questions, oui, mais elle n’a jamais supprimé notre besoin de sens. D’autres récits sont venus combler ce vide : l’ésotérisme et le développement personnel.
Le développement personnel, justement, fonctionne comme une nouvelle grande histoire, un méta-récit qui redonne du sens à nos existences et justifie l’ordre du monde. Pendant des siècles, la religion – ici le christianisme – jouait ce rôle. Puis la science a pris le relais, avant qu’on s’aperçoive qu’elle ne rendait pas forcément heureux. Alors, de nouveaux récits ont émergé : un mélange de psychologie, de nature et de spiritualité, censé remettre un peu d’harmonie dans nos vies. Derrière la diversité des pratiques, on retrouve toujours les mêmes idées : le rejet des institutions, la sacralisation de la nature et de l’individu.
Le développement personnel prend la fonction sociale de la religion, c’est pour cela que j’ai repris la formule marxiste d“opium du peuple” pour le titre du livre. L’opium est une drogue extrêmement agréable qui permet de mieux vivre, comme le développement personnel : quand on est dedans on se dit “je suis malheureux, mais ce n’est pas grave, je vais travailler sur moi et ça ira mieux, je vais m’en sortir”. C’est ce que que disait le christianisme : prie Dieu et ça ira. Mais je parle aussi d’opium, car quand on est là-dedans, on ne pense pas réellement à changer le monde, parce que dans le développement personnel, tout est histoire de subjectivité propre aux individus.
Le Poing : Vous parlez de la centralité de la subjectivité dans le développement personnel, pourtant, dans votre livre, vous évoquez la volonté de certains acteurs de ce milieu de donner une scientificité à leur pratique, notamment la méditation en pleine conscience. Il y a donc une tentative de ré-objectivation par la science de la subjectivité ?
D. K. : Le cœur du problème avec le développement personnel, c’est que tout y est subjectif. Ce qui me rend heureux ne te rendra pas forcément heureux, et inversement. Pourtant, on vit dans une époque où le bonheur tend à être pris comme une obligation morale, ce que la sociologue Eva Illouz a très bien montré dans Happycratie. On nous inonde de méthodes et de recettes pour aller mieux, mais comment garantir que tout ça marchera ?
C’est l’un des paradoxes du développement personnel : certes il critique la science, mais d’un autre côté, elle est aussi la seule chose que l’humanité ait trouvée pour dépasser la subjectivité. Sauf que là, on essaie de rendre scientifique quelque chose de très abstrait : le bonheur, le bien-être, la paix intérieure. Comment mesurer ça ? Avec un scanner ? Un questionnaire ? C’est tout le paradoxe du développement personnel : il cherche des certitudes dans un domaine où, par essence, il semble difficile d’en envisager. Et le résultat de cette approche est une angoisse terrible puisqu’il laisse entendre que si je ne vais pas bien, c’est que je n’ai pas “travaillé sur moi” comme il l’aurait fallu.
Le Poing : On a beaucoup chroniqué dans nos colonnes l’arrivée de ces pratiques et de ces discours dans les institutions publiques, notamment à la fac avec le fameux master « Quantique du leadership capacitant et vibratoire » de l’Université Paul-Valéry, ou la suggestion par le Département de l’Hérault d’utiliser la biodynamie, concept anthroposophe, pour remettre en culture le foncier agricole. Comment expliquer cet entrisme ?
D. K. : Ce qui rend le développement personnel si puissant, c’est sa capacité à raconter des histoires. Il met en récit nos existences et redonne du sens là où il s’est effondré. Dans un monde où beaucoup ne savent plus très bien pourquoi ils se lèvent le matin, ces récits offrent un cadre rassurant.
Prenez la biodynamie, par exemple : on y dit que l’agriculture est reliée au cosmos, que les cycles lunaires guident les semailles… Tout ça recrée un sentiment d’ordre, une cohérence symbolique dans un monde qui paraît de plus en plus chaotique et qui est surtout en crise depuis plusieurs décennies.
À l’université, c’est le même ressort. Il y a un profond malaise institutionnel : perte de sens, surcharge, sous-financement. Ces pratiques peuvent apparaître comme un exutoire, parfois même comme une manière de se réconcilier avec son métier. Certains enseignants s’y engagent sincèrement, d’autres y voient une opportunité plus pragmatique : créer un diplôme “quantique” ou “vibratoire”, c’est non seulement la possibilité d’enseigner ce qu’on aime vraiment, mais aussi la possibilité de faire des heures supplémentaires.
Si les universités – et notamment les filières de sciences humaines – étaient correctement financées et gérées, ce genre de formations seraient probablement moins fréquentes.
Et cette logique dépasse largement le monde universitaire. On la retrouve dans le système de santé, où la déshumanisation du soin pousse des patients vers les médecines alternatives. Beaucoup de gens me disent : “mon naturopathe m’écoute, mon généraliste non”. Autrement dit, ces pratiques prospèrent sur les failles du service public : elles occupent les espaces laissés vacants par les services de l’État. Là où les institutions se retirent, le développement personnel s’installe,
Le Poing : on voit aussi arriver dans les milieux militants des pratiques comme le “travail qui relie”, un rituel inspiré du bouddhisme, notamment dans une certaine fanges de l’écologie, ou des ateliers pour “militer en pleine conscience” dans certains lieux associatifs militants. N’y a-t-il pas un paradoxe à voir arriver du développement personnel dans des espaces normalement dédiés à l’action collective ?
D. K. : Ce n’est pas si paradoxal que ça, justement. Le développement personnel donne l’impression de reprendre la main sur sa vie, dans un monde où tout semble nous échapper.
Face au sentiment d’impuissance politique – et il suffit de penser au référendum de 2005, où le “non” a été ignoré -, beaucoup se sont dit : “puisqu’on ne peut pas changer le monde, essayons au moins de nous changer nous-mêmes.” C’est une façon de réintroduire de la maîtrise, mais au prix d’un renoncement collectif.
Ce basculement du “nous” vers le “moi” traduit quelque chose de très contemporain : la conviction que la transformation du monde passe par la transformation de soi. Dans mes entretiens, j’ai souvent vu cette logique à l’œuvre. Par exemple, quelqu’un me racontait : “l’entreprise dans laquelle je travaille va mal, j’ai une pression énorme, mais mon maître reiki me dit de lâcher prise, que je donne mon énergie à un système toxique.” On voit bien que le diagnostic est juste – il y a un malaise social évident – mais la réponse est déplacée : on soigne le symptôme au lieu de questionner la cause.
Et puis il y a un autre paradoxe : le développement personnel se présente comme une démarche individuelle, mais il a une dimension collective utilitaire. On est censé “utiliser” les autres pour s’élever soi-même, comme des miroirs de notre progression intérieure. Et la conviction sous-jacente, c’est que si tout le monde devient une “meilleure version de soi-même”, le monde finira par aller mieux.
C’est une forme d’utopie individualiste – très compatible, d’ailleurs, avec certains milieux militants persuadés d’incarner une avant-garde. On ne change plus le système : on s’élève au-dessus.
Le Poing : Selon vous, quelle réponse politique collective apporter pour contrer l’emprise du développement personnel ?
D. K. : Il faut recréer du commun. Le développement personnel prospère sur le vide laissé par l’effondrement des collectifs, donc la réponse ne peut pas être individuelle. Il faut redonner aux gens le sentiment d’appartenir à quelque chose de plus grand qu’eux comme une communauté, un projet ou un horizon partagé.
Ça passe par l’école, évidemment : former des citoyens, pas des consommateurs de bien-être. Et par des services publics forts, qui incarnent justement ce commun.
Le Poing : Le développement personnel peut faire l’objet de dérives. Quelles sont-elles, comment les repérer ?
D. K. : Oui, bien sûr, mais il faut garder la mesure. Les dérives existent, mais elles restent minoritaires. La plupart des gens attendent des résultats, et quand ça ne marche pas, ils partent. Il y a une forme d’autorégulation naturelle. Les praticiens se critiquent d’ailleurs beaucoup entre eux, c’est assez amusant à observer.
Les vrais risques commencent quand la relation de confiance devient trop forte. Pour que le développement personnel “fonctionne”, il faut un imaginaire partagé, un langage commun… Et quand ce lien se referme sur lui-même, ça peut vite dériver vers de l’emprise. C’est ce qu’on voit quand quelqu’un finit par dépenser tout son argent là-dedans, ou s’isoler complètement de son entourage.
Mais tout n’est pas si simple. J’ai connu un cas où un médiateur avait conseillé à une personne de couper les ponts avec sa famille, qu’il jugeait “toxique”. Sur le moment, ça m’a semblé être un signal d’alerte évident… jusqu’à ce que j’apprenne que cette personne était victime d’abus au sein de sa famille. Était-ce le rôle du médiateur d’intervenir à ce point ? Cela se discute. Mais dans son intention, il n’y avait pas de volonté de nuire, plutôt celle de protéger.
C’est ça, le cœur du problème : tout est subjectif. Entre aide sincère et influence nocive, la frontière est souvent ténue et elle dépend moins des méthodes que de la relation humaine elle-même.
Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :
ARTICLE SUIVANT :